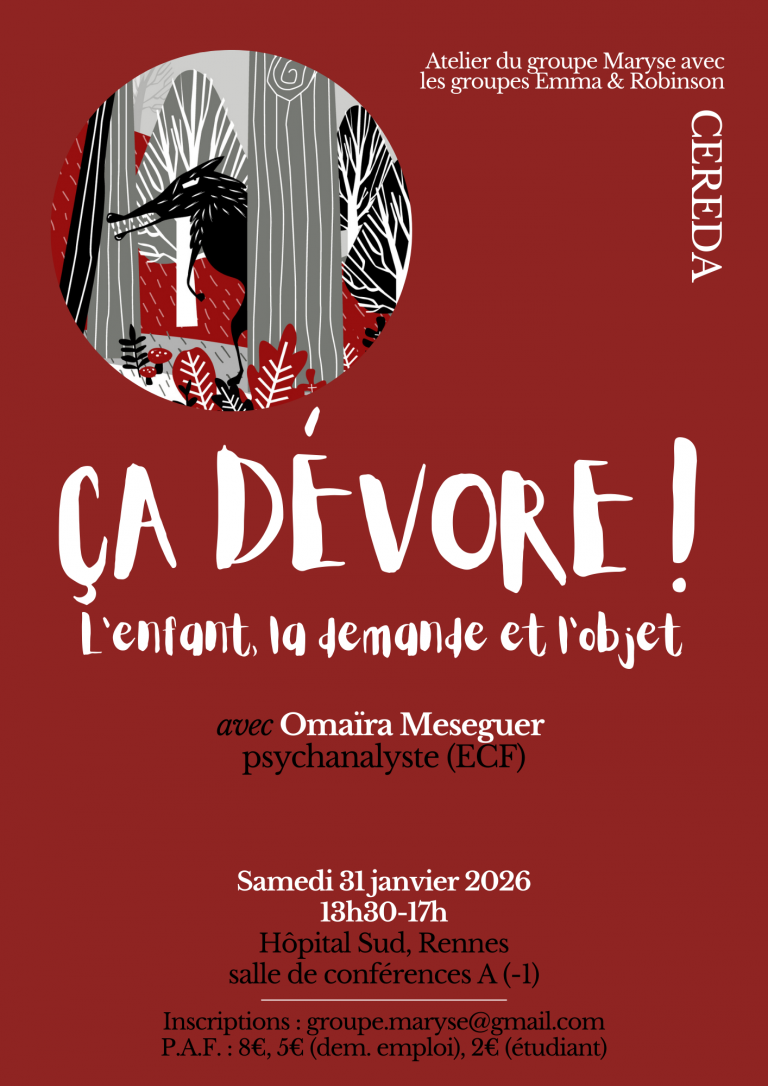« Qu’est-ce qu’une demande orale ? [1] » La demande d’être nourri, dès qu’elle est véhiculée par le langage et adressée à un autre, vise autre chose que la simple satisfaction d’un besoin. Elle constitue le premier lien du petit d’homme à l’Autre. C’est dans l’écart entre le besoin et la demande que vient se loger le désir.
La première découverte de Freud concernant les objets de l’enfant se rapporte à l’oralité. Ainsi, le suçotement (ludeln) « consiste en un contact de succion avec la bouche […], lequel est rythmiquement répété, l’ingestion de nourriture étant une fin exclue [2] ». Il s’agit d’un artifice créé par l’enfant pour obtenir une satisfaction déjà vécue, dérivée de cette « union la plus radicale [3] » avec l’Autre maternel et désormais remémorée. La langue, les lèvres, le doigt, la tétine ne sont pas des substituts du sein, mais des objets mis au service d’une satisfaction substitutive.
Lacan évoque le rêve de la petite Anna Freud, où elle hallucine les friandises qui lui avaient été interdites, pour montrer « qu’il n’y a pas purement et simplement présentification des objets d’un besoin [4] », mais d’objets désirables. La fillette n’avait pas spécialement faim, mais rêvait de ce qu’elle aurait aimé manger.
Que dire d’un enfant qui ne cesse pas de manger, tel un Gargantua, ce petit goinfre inassouvi, nourri par des milliers de vaches ? Comment interpréter les plaisirs de la bouche – téter, sucer, mordiller, goûter – pour explorer le monde, le désirer ou tenter de le repousser ?
« Il n’y a point de fantasme de dévoration […] que nous ne tenions pour impliquant […] une inversion [5] », où se manifeste la peur d’être dévoré. Lacan insiste sur la réversibilité de la pulsion : manger, être mangé, se faire manger constituent les trois temps de la pulsion orale.
Ainsi Hansel et Gretel [6], attirés par une irrésistible maison de pain d’épices qu’ils n’hésitent pas à croquer, sont capturés par « une sorcière mangeuse d’enfants [7] », mais finissent par retourner la situation en la poussant dans le four, où elle est dévorée par les flammes.
À l’autre extrême se trouve l’enfant qui ne mange pas, qui cesse de s’alimenter. Parfois, le refus de la nourriture apparaît comme limite à un excès venant de l’Autre, comme l’unique solution pour préserver son propre désir. L’anorexie des jeunes adolescents en témoigne. L’objet, dans ce cas, n’est pas la nourriture, mais le rien. Il ne s’agit pas de dire que l’anorexique ne mange rien. Lacan souligne : « dans l’anorexie mentale, ce que l’enfant mange, c’est le rien [8] ».
Dans « La théorie du partenaire » [9], Jacques-Alain Miller propose que l’anorexie relève de la séparation, le rejet de l’Autre étant au premier plan, tandis que la boulimie s’inscrit du côté de l’aliénation, avec le lien à l’Autre mis en avant.
Et que dire d’une bouche « cousue », sinon que bien souvent le silence incarne « l’instance pure de la pulsion orale, se refermant sur sa satisfaction [10] » ? Quel est le rapport entre la parole, le langage et la pulsion orale ?
La pulsion orale se manifeste également dans la gourmandise du surmoi : vorace, insatiable. Pour Lacan, cette gourmandise « est structurale, non pas effet de la civilisation, mais “malaise (symptôme) dans la civilisation” [11] ». Le surmoi n’est pas simplement issu du comportement de l’entourage de l’enfant ou de ses parents. Il importe de le rappeler à une époque où l’on parle volontiers de discipline ou d’éducation positive. Considérer le surmoi comme structurel permet d’aborder autrement la question de la culpabilité et d’en mesurer les effets parfois ravageants chez l’enfant.
Dans un autre registre, comment aborder aujourd’hui la dépendance aux drogues, la toxicomanie ? ou encore cette consommation dévorante d’écrans et des réseaux sociaux ?
Que peut-on dire des formes possibles de sublimation de la pulsion orale par l’incorporation du signifiant, comme le suggère Lacan à partir de l’expression « manger le livre [12] », empruntée à l’Apocalypse de Saint Jean ? Comment vient à l’enfant le désir de savoir, « l’avidité curieuse [13] » si déterminante dans son développement individuel ?
Autant de questions présentes dans la clinique de l’enfant et de l’adolescent, à explorer sans modération.
Comme le rappelle le monstre Chapalu : « Celui qui mange n’est plus seul [14] ».
Rendez-vous à la prochaine journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant du Champ freudien, le 20 mars 2027 !
[1]. Lacan J., Le Séminaire, livre VIII, Le Transfert, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2001, p. 242.
[2]. Freud S., Trois essais sur la vie sexuelle, in Œuvres complètes, t. VI, Paris, PUF, 2006, p. 115.
[3]. Lacan J., Le Séminaire, livre VIII, Le Transfert, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2001, p. 243.
[4]. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.‑A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 142.
[5]. Lacan J., Le Séminaire, livre XII, Problèmes cruciaux, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien, 2025, p. 134.
[6]. Cf. Grimm J. & W., « Hansel et Gretel », Contes de l’enfance et du foyer, Paris, Gallimard.
[7]. Bettelheim B., Psychanalyse des contes de fées, Robert Lafont, Pocket, 1976, p. 253.
[8]. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux…, op. cit., p. 96.
[9]. Miller J.-A., « La théorie du partenaire », Quarto, no 77, juillet 2002, p. 17, rééd. Pharmakon, no 4, mai 2023, disponible sur pharmakondigital.com.
[10]. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux…, op. cit., p. 164.
[11]. Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 530.
[12]. Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 371.
[13]. Lacan J., Le Triomphe de la religion précédé de Discours aux catholiques, Paris, Seuil, 2005, p. 54.
[14]. Apollinaire G., L’Enchanteur pourrissant, Poésie/Gallimard, Paris, 1992, p. 49, cité par J. Lacan, in Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, p. 363.