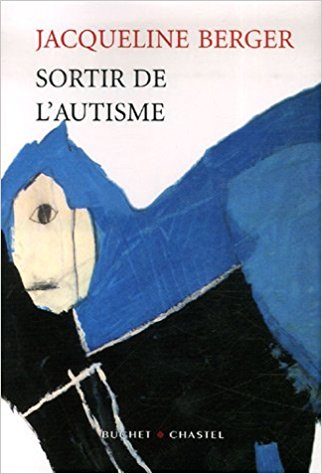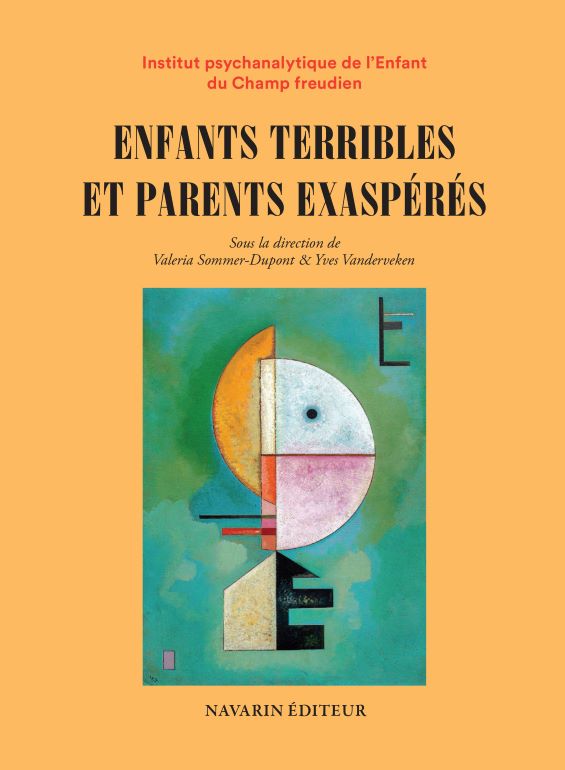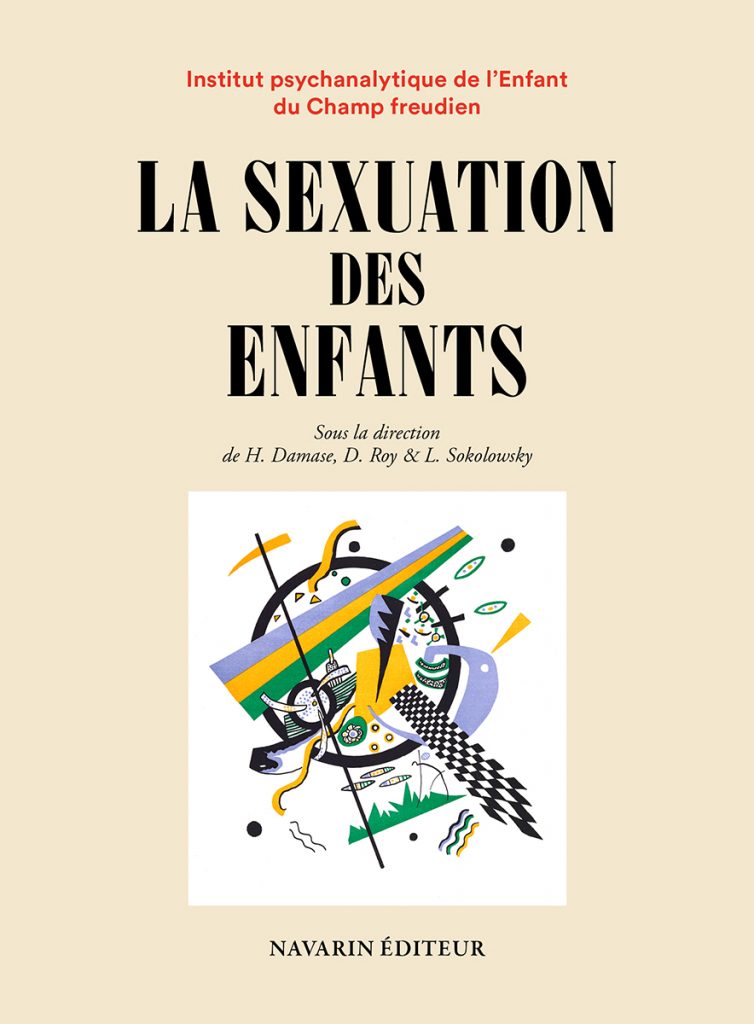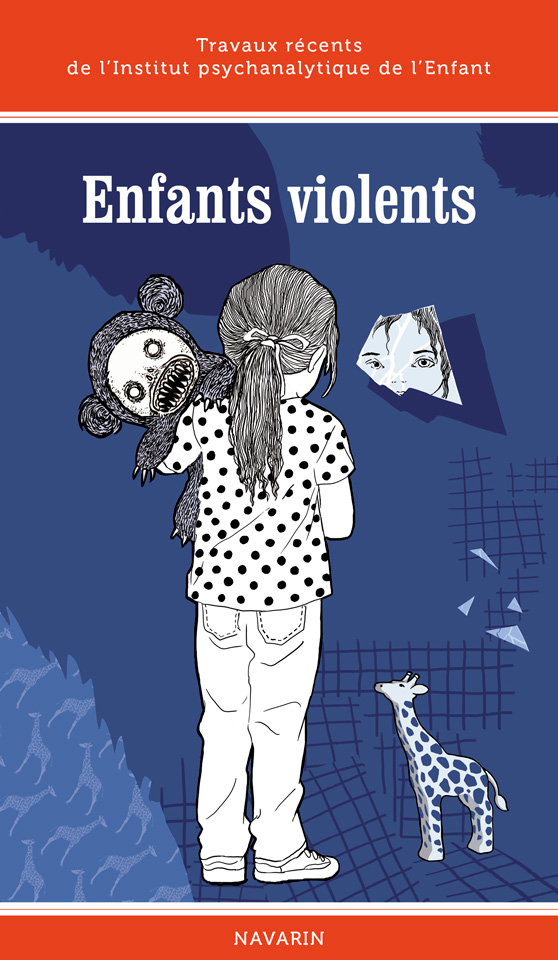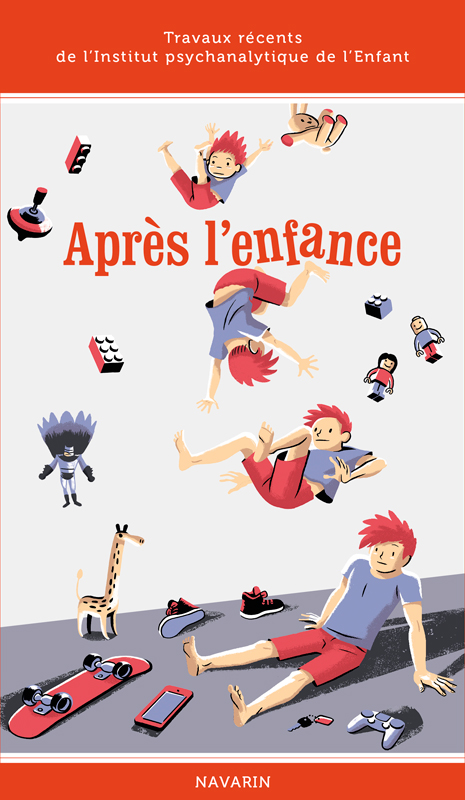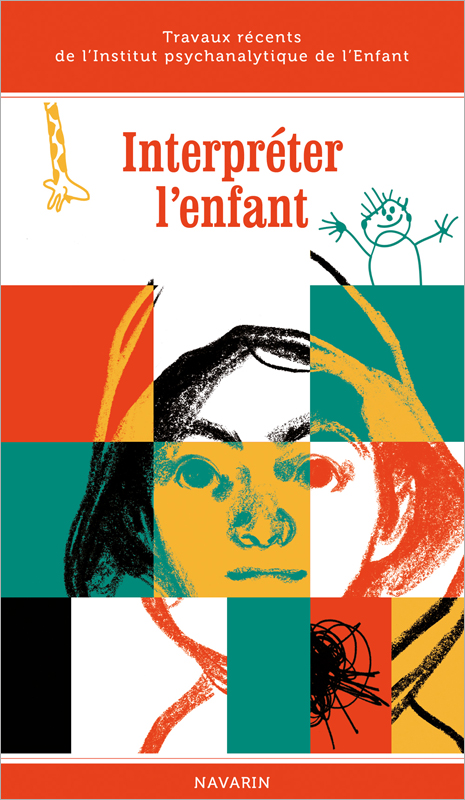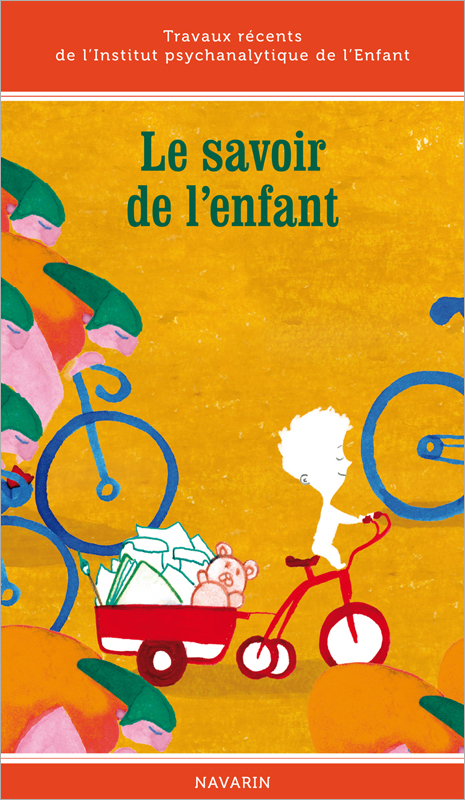Jacqueline BERGER
2007
L’auteur est journaliste et mère de jumelles de seize ans ayant souffert d’un syndrome autistique. L’autisme n’est pas une fatalité. Tel est le fil conducteur de cet essai à contre-courant d’une époque qui renonce à soigner les difficultés psychiques et étiquettes les individus dès le plus jeune âge.
« Comment dans cette atmosphère d’hypocrisie productive, accueillir l’autre, mon semblable, dans sa défense, son esseulement ? »
Cette question posée par Jean Oury, Jacqueline Berger y répond avec un grand courage. Rares sont les journalistes qui, comme elle, ou comme Patrick Coupechoux, engagent leur parole à contre-courant des discours médiatiques dominants, refusant de réduire l’autre à ses apparences ou à son comportement manifeste.
Armée de sa simple expérience, elle refuse dans Sortir de l’autisme la fatalité du handicap qui enferme à jamais l’être en souffrance dans un avenir dévalué par sa programmation informatique. Elle s’insurge contre ces étiquetages vides qui stérilisent la pensée contre les pratiques gestionnaires qui commercialisent le prêt à parler pour adapter l’accueil et le soin aux produits des supermarchés, contre ces pseudosciences dites humaines, enfin, cognitivo-comportementales, dont le réductionnisme engendre des robots assagis.
Mais son grand mérite consiste à exposer, à partir d’une expérience douloureuse de l’autisme au quotidien, ses propres interrogations sur la condition humaine faite de doute, de fragilité, c’est-à-dire du cristal singulier d’un sujet incalculable. « Ceux qui savent » ont accumulé, depuis des décennies un véritable catalogue à la Prévert des causes organiques de l’autisme : génétiques, physico-chimiques, biologiques, neurologiques. Les chercheurs, qui n’ont pourtant rien trouvé, ont accrédité, dans l’esprit du public, l’hypothèse d’une maladie spécifique, scientifiquement établie, stigmatisant ainsi une essentielle différence.
Car l’idéologie scientiste, dans sa quête de la cause, a pour visée inconsciente, d’améliorer, pour les rentabiliser, les « ressources humaines ». Pour Jacqueline Berger, l’autisme n’est pas une fatalité, un déficit inscrit dans les lois du corps : « N’être autiste » nécessite de repérer la blessure du sentiment d’existence qui anime le petit être parlant. Il est urgent, aujourd’hui, de créer, ou de recréer, des « lieux où renaître », des « lieux pour vivre », des « lieux pour dire », qui permettent à un enfant, quelque soit l’étiquette plaquée sur sa souffrance, de trouver une place reconnue et valorisante par laquelle il deviendra l’auteur de sa propre vie.
Pour cela, il faut, d’abord et avant tout, respecter des parents blessés, en proie à l’angoisse de l’inconnu. Leur démarche, face à un pouvoir qui les instrumentalise, doit être entendue dans sa complexité inconsciente. Elle implique un travail personnel dans une relation de confiance qui leur permette de reconnaître, rencontrer et entendre leur enfant, dans sa différence.
Il faut avoir le courage de Jacqueline Berger pour se distancier des positions “victimaires” et s’aventurer dans l’expérience singulière, sensible et douloureuse d’accueil et d’accompagnement de cette différence. Douleur, dont les polémiques stériles sur les causes de l’autisme sont, sans aucun doute, la formulation malheureuse, et constituent la principale résistance à ce que Freud appelait “le travail de la civilisation”.
Jacqueline Berger laisse entendre que cette nouvelle maladie de l’âme pourrait bien être le symptôme du monde contemporain dont le discours dominant flatte les techniques déshumanisantes qui en masquent l’expression. Une “abstention de la vie” guette chacun, replié sur sa propre image pour se défendre du risque de l’Autre, dans un “désir féroce de ne pas connaître” , de type autistique. Chaque citoyen, numérisé dès sa naissance, sera-t-il dépouillé de sa singularité subjective, jugée déviante, pour renforcer la gouvernance thanatocratique du narcissisme de masse ?
Sortir de l’autisme, refusant la désagrégation du lien collectif, s’adresse à tout le monde.
« L’ordinaire du glissement dans la barbarie : il n’y a pas de grands événements ni de cataclysme qui pourraient en donner la raison. Rien qu’une lente dégringolade au quotidien, jusqu’à l’absurde, jusqu’à un point où se munir d’une carapace devient nécessaire pour tous. Pour les non courageux que nous sommes tous ; tous êtres humains si fragiles ».
Confronté à la question humaine de la folie, Jacqueline Berger a l’immense mérite de refuser la dégringolade. C’est un appel d’humanité, qui fait valoir le travail en institution avec les enfants, tout en revendiquant la référence freudienne, indice de la liberté du sujet parlant.