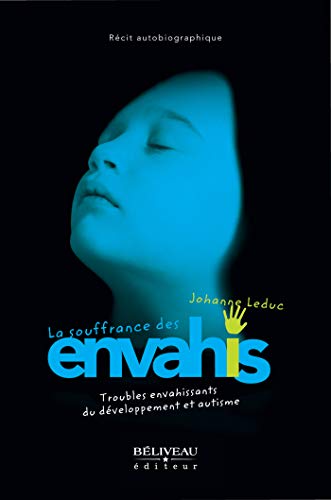Johanne Leduc est mère au foyer après avoir fait des études de design. Elle habite au Québec et elle n’a aucune connaissance de l’autisme quand on lui annonce ce diagnostic en 2005 pour l’un de leurs enfants. Lorsqu’elle s’informe sur internet, elle constate que les opinions convergent : la méthode ABA fait des miracles.
Le programme était simple, lui enseigna Anne-Marie Dubé, une spécialiste réputée de l’ABA au Québec, « montrer à l’enfant que l’adulte est supérieur et que l’enfant doit lui obéir[1]». Johanne constate d’emblée que la méthode est « barbare » : « mon fils semble heureux et dès qu’il entre en thérapie, il se met à pleurer[2]», et même il « se griffe les joues ». Après coup elle note que cette première manifestation d’auto-agressivité n’a été remarquée par personne[3]. Or par la suite le phénomène s’amplifiera grandement.
À partir de ses trois ans jusqu’à ses sept ans, Simon fut soumis de manière intensive à la thérapie ABA par des professionnelles venant à son domicile et par ses parents. Le coût de quatre ans de thérapie, à raison de six à huit heures par jour, fut considérable, Johanne le chiffre à soixante-cinq-mille dollars, elle ne put l’assumer que grâce à une aide de quatorze-mille-cinq-cents dollars accordée par une fondation cherchant à développer la pratique de l’ABA.
Quel fut le résultat de tant d’efforts ? Mutique et encoprésique, Simon ne l’était guère moins au terme du traitement. Cependant, écrit Johanne, « avant qu’Anne-Marie ne débarque avec ses gros sabots, Simon était un enfant joyeux qui courait et riait. Certes, il était enfermé dans son monde, mais quatre années plus tard, ce même enfant est toujours enfermé dans son monde, et il passe la majorité de sa journée à pleurer en se massacrant. Il n’arrive même plus à manger assis à une table. Alors, qu’avons-nous gagné à lui fourrer de force de la nourriture entre les dents ?[4]». « La thérapie barbare de Miss Perfection n’avait servi à rien. Non, erreur. Elle avait servi à traumatiser mon garçon face à la nourriture pour le reste de ses jours. Lui faire avaler de force son repas n’avait fait qu’amplifier sa colère et son angoisse envers l’humanité. De plus en plus violent, Simon était devenu méconnaissable ». Qu’a‑t-il finalement appris après quatre ans de conditionnement ? « Quelques pictogrammes pour communiquer[5]».
Le plus grave fut le développement de conduites auto-mutilatrices, qui n’étaient pas présentes au début du traitement, et qui semblent être apparues dès les premières séances à l’occasion de griffures sur les joues. Pourquoi se frappe-t-il si souvent ? demande Johanne à un pédopsychiatre. Il lui répond avec bon sens qu’il a peut-être été trop soumis aux exigences de la méthode ABA[6]. Le premier effet de celle-ci n’est-il pas de mettre en échec l’enfant ? Cela ne peut-il pas altérer sa confiance et sa perception de lui-même ? Au terme de l’expérience Johanne en fait fortement l’hypothèse.
Cependant, pour la thérapeute ABA si les résultats sont si médiocres, c’est essentiellement la faute à un manque d’implication de la mère. Elle a pourtant tout abandonné pour se consacrer à son fils jusqu’à l’épuisement. Peu importe ce qu’elle faisait, ce n’était jamais suffisant. Anne-Marie Dubé lui reprochait de ne pas être assez ferme avec les membres de sa famille, selon elle « la plus bornée et la plus difficile [qu’elle ait] jamais vue[7]», parce que trop laxiste avec l’enfant, ce qui provoquait, note Johanne, « une ambiance de merde à la maison[8]». Il est vrai qu’elle était terriblement dérangée d’être parfois obligée de forcer son fils à avaler une bouchée recrachée[9] et que les membres de sa famille n’adhéraient pas toujours à la violence de la méthode. La thérapeute avait fini « par créer l’illusion d’une incompétence parentale chronique[10]». Johanne en arriva à la détester, tout en la tolérant, et en essayant de se soumettre à ses exigences, croyant faire ainsi pour le bien de son enfant.
Cependant, alors que ses doutes vont croissant concernant la pertinence de la méthode employée, Johanne assiste à une formation sur la rencontre de l’enfant autiste, donnée par une psychologue orientée par les méthodes développementales. Johanne l’entend avec surprise prôner l’inverse de ce qu’on lui a présenté comme une vérité scientifique avérée : « Vous devez respecter leur rythme, leurs goûts et leurs choix. Ne JAMAIS leur imposer les vôtres. Très important » et chercher à adapter l’enseignement à leur passion[11]. Johanne en vint alors à faire le constat qu’elle ne savait pas ce que son fils aimait. « Pis encore, écrit-elle, nous n’avions même pas cherché à le savoir[12]». Il est vrai que dans la logique de l’approche comportementale cette question ne se pose pas puisqu’elle fait méthodologiquement l’impasse sur la psychologie du sujet : seuls comptent le savoir et la technique du thérapeute. Johanne se demande alors pourquoi ce qui anime son enfant n’a pas été recherché. Pourquoi devions-nous le maintenir continuellement occupé ? Pourquoi devions-nous lui imposer notre mode de vie ? Le sien ne valait-il rien ? Pourquoi, s’interroge-t-elle encore, ne pas avoir laissé à Simon la liberté de regarder où bon lui semble ? À l’instar de beaucoup d’autistes, le contact visuel direct l’angoisse ; mais selon la méthode ABA, il faut le forcer à regarder dans les yeux. Johanne constate pourtant que « le fameux contact visuel, tant exigé par Anne-Marie, n’était pas crucial pour Simon. Au contraire. Si, terrée dans la cuisine, la tête dans le frigo ou dans l’armoire, je demandais à mon fils de me donner un bisou, Simon entrait dans la cuisine et m’embrassait. Le plus simplement du monde. Par contre, si j’exigeais un contact visuel, Simon décampait au sous-sol[13]». Elle se rend peu à peu à l’évidence : les thérapeutes ABA lui ont interdit tout ce qu’il aime, tout ce qui l’amuse et l’apaise. Ce fut, constate-t-elle, une erreur fatale[14].
Après avoir abandonné l’ABA, et expérimenté le peu d’efficacité de nombreux médicaments et traitements divers, Johanne découvre empiriquement l’affinity therapy. En se demandant quels sont les goûts de son fils, elle constate qu’il s’intéresse à l’ordinateur et peut même nourrir une passion pour un chien. Elle abandonne alors la rigueur du quotidien qui lui était imposé et le laisse maître de ses choix. Elle constate que ses épaules se redressent et qu’il semble reprendre confiance en lui. « La position de son corps, écrit-elle, passa d’homme de Cro-Magnon à Homo Sapiens[15]».
Il est important de noter qu’après l’abandon de la méthode ABA, Simon fut en mesure de commencer à développer l’une des principales méthodes propres au sujet autiste pour se protéger de l’angoisse : la création d’un objet autistique. « Simon, rapporte sa mère, s’était lié d’amitié avec une vieille couverture en polar rouge qui traînait au sous-sol, et en s’enroulant dans sa doudoune, il ne se frappait plus […] cette couverture semblait lui procurer le réconfort dont il avait besoin […] il ne la quittait jamais, et quand je dis jamais, je veux dire jamais ! Même dans son bain ![16]». Inutile de préciser qu’un tel comportement atypique n’aurait pu être toléré par la méthode ABA, de sorte que pour traiter son angoisse il ne resta à Simon que des conduites d’auto-agressivité. Pourtant, si l’on cherche à s’enseigner des conduites de l’autiste, si l’on suppose qu’il est un sujet qui possède un savoir sur la manière de se protéger de ses angoisses, on constate régulièrement qu’il a besoin d’objets protecteurs et rassurants. Outre la couverture, Simon se mit à investir un autre objet, un chien, qui selon l’ABA ne peut que le détourner de ses apprentissages. Or, constate sa mère, c’est fou tout ce que Simon arrivait à faire grâce à l’animal. « Pitou sur les genoux, Simon se mit à dessiner, à se brosser les cheveux, à reconnaître le nez de la bouche, à faire manger Rubber, son bébé en caoutchouc – toujours vivant –, à donner des ordres et à tenir la laisse du chien. L’obéissance du petit pitou fut, à mon sens, une véritable révélation pour Simon. Une sensation extraordinaire qui pouvait se lire sur son visage. Fier et fringant, Simon se pavanait avec son chien. Ce sentiment de supériorité sur un être vivant, devenu inférieur, le transforma[17]».
La mise en place de ces objets protecteurs n’a cependant pas empêché des rechutes : encoprésie et auto-agressivité insistent chez Simon. Ces conduites, qui se sont mises en place à des moments décisifs de sa construction subjective, semblent s’être ancrées dans son fonctionnement. L’obstacle majeur à la découverte tardive par Johanne d’un savoir propre à son fils, pour se protéger de ses angoisses et pour se construire, réside dans sa conviction initiale, poursuivie de longues années, selon laquelle le bien de son enfant devait passer par l’imposition d’un savoir présenté comme scientifique, dont l’échec ne pouvait être dû qu’à l’incompétence parentale. Son poignant témoignage, La souffrance des envahis, publié en 2012 au Québec, passé sous silence en France, constitue un remède à la culpabilisation des parents propagée sur internet à l’égard de ceux qui ont l’outrecuidance de ne pas soumettre leur enfant à la méthode ABA.
[1]Leduc J., La souffrance des envahis. Troubles envahissants du développement et autisme, Québec-Canada, Beliveau, 2012, p. 111.
[2]Ibid., p. 63.
[3]Ibid., p. 67.
[4]Ibid., p. 272.
[5]Ibid., p. 303.
[6]Ibid., p. 214.
[7]Ibid., p. 115.
[8]Ibid., p. 114.
[9]Ibid., p. 116.
[10]Ibid, p. 184.
[11]Ibid., p. 257.
[12]Ibid., p. 256.
[13]Ibid., pp. 269–270.
[14]Ibid, p. 167.
[15]Ibid., p. 271.
[16]Ibid., pp. 307–308.
[17]Ibid., p. 308.