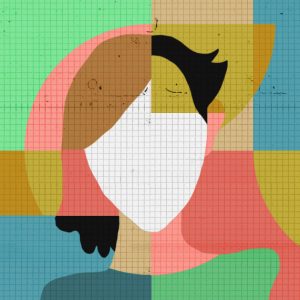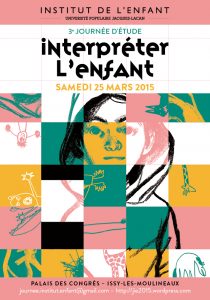L’Institut de l’Enfant a donc été inauguré ce jour avec cette série de travaux sur les peurs d’enfants. Le choix de ce thème se justifiait, étant donné que le texte majeur que Freud consacre à l’enfant, et sinon à la psychanalyse de l’enfant, du moins à son inscription dans le discours analytique, est l’analyse d’une phobie qui, comme vous le savez, prend l’allure d’une peur, peur irraisonnée des chevaux. Cette Journée inaugurale peut donc être considérée comme une commémoration de ce grand texte.
Quel thème pour la seconde Journée qui aura lieu dans deux ans ? Quel thème qui fasse couple avec « peurs d’enfants » et qui fasse avec lui un effet de sens ?
La peur, c’est pathétique, c’est un affect. Allons donc chercher un terme qui lui soit opposé de façon polaire. Ce doit être un terme qui appartient au registre que nous disons du signifiant. C’est d’autant plus justifié qu’une phobie, si ça s’éprouve au niveau de l’affect, ça s’analyse au niveau du signifiant. Et c’est au point que, dans la cure du petit Hans, la phobie a pu être définie par Lacan comme « un cristal signifiant ». Un cristal signifiant, c’est une formation de l’inconscient faite d’un nombre limité de signifiants dont l’enfant explore toutes les permutations possibles. Une phobie, ce n’est pas une peur, cela ne se réduit nullement à une peur. Une phobie, telle qu’elle se révèle dans une cure d’orientation analytique, c’est une élucubration de savoir sur la peur, ou sous la peur, dans la mesure où elle est son armature signifiante.
C’est de cette réflexion, très simple, d’où procède le choix que j’ai fait du thème de la prochaine Journée, soit « L’enfant et le savoir ». Ce thème à son tour fait lever des réflexions que je vous livre afin d’ouvrir un champ et non pas pour le fermer. Dans les deux ans qui nous séparent de cette prochaine Journée, ceux qui se réfèrent à ce nouvel Institut de l’Enfant auront le temps d’explorer ce champ.
Une fois que c’est dit, je trouve que l’enfant et le savoir sont deux mots qui vont très bien ensemble, car l’enfant est, si l’on peut dire, la victime toute désignée du savoir.
Qu’est-ce qu’un enfant en effet ? Il n’est pas trop tard pour poser la question.
Un enfant, c’est le nom que nous donnons au sujet pour autant qu’on le voue à l’enseignement, sous les espèces de l’éducation. L’enfant, c’est le sujet à éduquer, ce qui veut dire le sujet à conduire, à mener, comme le confirme l’étymologie, qui nous réfère au latin ducere, qui est un verbe dérivé du substantif dux, le chef.
Ainsi l’enfant est par excellence le sujet livré au discours du Maître par le biais du savoir, c’est-à-dire par l’entremise du pédagogue. Là aussi, l’étymologie nous rappelle que « pédagogue », c’était le nom de l’esclave chargé de conduire les enfants.
Donc, le savoir dont il s’agit peut bien parader comme maître, mais ce n’est qu’au titre de semblant. Le maître vrai, le maître qui est la vérité de ce semblant, on ne le voit pas, et c’est ce que Lacan a traduit dans son algèbre en écrivant sous le signifiant S2, une barre, et en dessous S1 : S2/S1. Le maître est caché sous l’apparence d’un savoir-maître, qui n’est que savoir d’esclave pour conduire les enfants, qui sont eux en quelque sorte les esclaves de l’esclave.
Ce que Lacan a appelé le discours de l’Université, nous pouvons le considérer comme la structure générale de tous les appareils où le savoir est en position de semblant et dont les enjeux sont en fait de pouvoir. Et l’enfant, aujourd’hui, est un enjeu de pouvoir et nous avons à dire où nous nous inscrivons devant ce spectacle.
Ainsi, les controverses actuelles sur l’éducation sont-elles de part en part politiques. Il s’agit de rien de moins que de la production des sujets. Il s’agit toujours de réduire, de comprimer, de maîtriser, de manipuler la jouissance de celui que l’on appelle un enfant pour en extraire un sujet digne de ce nom, c’est-à-dire un sujet assujetti.
Et nous assistons à ceci, qui est croissant : une concurrence des savoirs, une rivalité des traditions, une lutte des transmissions, qui se donnent à qui mieux mieux pour déterminer quel savoir l’emportera sur l’autre dans la production des sujets, sous quelle emprise tombera l’enfant, pour mériter de devenir ce que, dans certains savoirs, l’on appelle un citoyen. Ceci est d’ailleurs particulièrement sensible quand il s’agit de l’enseignement de l’histoire.
Quelle histoire, se demande-t-on ? Faut-il enseigner celle du pays de résidence, celle de l’Europe, celle du monde, celle de la tradition ethnique et/ou religieuse à laquelle appartient un enfant ?
Simplifions la question en dessinant un triangle des savoirs, dont les sommets sont l’État, la famille et les médias :
- L’État, parce que nous sommes en France et qu’il y a dans ce pays une tradition dite républicaine qui prescrit un certain ordre de savoir à transmettre, un ordre de savoir dont les fondements ont été posés pendant la Troisième République.
- La famille, car c’est aussi la communauté ethnique et/ou religieuse, chrétienne, juive, musulmane, la communauté qui veut des sujets qui en perpétuent les pratiques et les croyances.
- Les médias pour autant que la distraction véhicule elle aussi un savoir qui modèle le sujet, et on s’interroge de façon répétitive sur les incidences que comporte le spectacle sur le sujet à éduquer, en particulier c’est spécialement intense à propos des spectacles de la violence.
Michel Foucault avait forgé le terme de « bio-politique »pour désigner la production des êtres vivants en tant qu’elle est devenue un enjeu de pouvoir. Dans cette même ligne, pourquoi ne pas parler, nous, d’« épistémo-politique », pour désigner la politique des savoirs qui concernent, qui visent spécialement l’enfant et qui cherchent à lui conférer une identité, par exemple l’identité que certains appellent « nationale ». La question est de savoir, à propos de l’enfant, quand se disputent ainsi les pouvoirs, de quels signifiants maîtres sera-t-il marqué. En tout état de cause, pour que le sujet puisse recevoir une marque identitaire, il faut que la jouissance de l’enfant soit décomplétée, qu’elle subisse une perte, qu’une ablation soit réalisée. C’est l’opération majeure du savoir-semblant. Nul n’en doute quand cette opération s’incarne dans une pratique comme celle de l’excision, mais celle-ci ne fait que manifester que tout savoir comporte une excision, tout savoir accomplit sur l’enfant une ablation, exige qu’il consente à une perte.
L’image traditionnelle de l’enseignement, c’est celle du nourrissage, de l’alimentation. C’est ce qu’exprime fort bien le petit nom latin donné à l’Université, que l’on trouve chez Rabelais, mais déjà auparavant chez les Romains, pour d’autres emplois : Alma mater, la mère nourricière. Nous pouvons déjà corriger cette image en songeant, comme le thème d’aujourd’hui est bien fait pour le rappeler, que ce nourrissage peut fort bien s’inverser en voracité et si, dans la gueule de la maman crocodile, il paraît qu’on peut mettre un petit bâton, on n’arrive pas à le mettre dans la gueule de l’appareil scolaire et universitaire, ou alors il faut que l’enfant se fasse lui-même ce petit bâton.
La psychanalyse nous inciterait plutôt à substituer à ce modèle oral de la transmission du savoir, une référence anale. La transmission de savoir exige toujours du sujet qu’il se vide de l’intérieur, qu’il lâche ce qui lui appartient en propre, qu’il se purifie du déchet qu’il contient. Et ce n’est pas par hasard que nous avons le témoignage de l’affect des tout premiers étudiants de l’Université de Paris, au moment de son institution, au XIIIe siècle, puisque nous nous avons les lettres qu’ils écrivaient à leur famille : ils témoignaient qu’ils s’emmerdaient.
La voix et le regard ne sont pas moins impliqués dans le rapport de l’enfant au savoir. Il faut qu’une voix porte le savoir. Les psychologues qui ont étalonné les résultats scolaires, témoignent que ça passe beaucoup mieux quand la voix du professeur est là pour supporter le signifiant. D’autre part, l’éducation vise à incorporer au sujet le regard de l’Autre de façon à ce que ce sujet lui-même se surveille, se contrôle, se dirige, comme si c’était l’Autre. Il faut que l’enfant incorpore quelque chose de l’Autre, et, par excellence, ce qu’il doit incorporer, c’est le regard de l’Autre.
Je dresse un portrait assez pathologique de l’école, mais cela fait bien voir que ce qu’on appelle psychothérapie est en fait du même registre que la pédagogie. La psychothérapie, c’est la pédagogie, dès lors qu’on accentue l’aspect curatif de l’éducatif, et moi, j’en accentue plutôt l’aspect pathologique ou pathogène.
Il revient à l’Institut de l’Enfant de dégager dans l’éducation la fonction que tient le désir de l’Autre. Cela veut dire aussi mettre en question la jouissance des pédagogues, leur jouissance infâme à opérer par le biais des semblants du savoir sur la jouissance de l’enfant. La vertu des pédagogues n’est souvent que l’habillage d’une jouissance que, même s’ils ne la connaissent pas, peut être qualifiée de sadique, avec les effets d’angoisse qui s’en suivent sur l’éduqué.
Il appartient à l’Institut de l’Enfant de restituer la place du savoir de l’enfant, de ce que les enfants savent. Et ils savent, ils en savent toujours plus que n’en soupçonnent les adultes, eux déjà crétinisés par leur éducation achevée :
- ils en savent déjà plus sur le langage, par anticipation, comme cela a pu être noté par le linguiste ;
- bien sûr, ils savent les secrets de famille ;
- ils savent le désir des parents, ne serais-ce qu’au titre d’en être le symptôme ;
- ils savent le désir des pédagogues ;
- ils ne se trompent pas sur le caractère de semblant des savoirs qu’on leur impose et sur le halo d’ignorance dont ces savoirs sont entourés et où ceux-ci trouvent leur assise.
Le savoir de l’enfant, au sens du savoir qu’il a, n’est pas de ces savoirs de semblant, de ces savoirs artificieux, qui sont montés en discours sur la même matrice que le discours de l’Université. Le savoir de l’enfant est un savoir authentique, qu’il soit su ou insu, et c’est à ce titre qu’il s’inscrit dans le discours analytique.
Je dirai le mot « respect » : dans le discours analytique, le savoir de l’enfant est respecté.
L’enfant entre dans le discours analytique comme un être de savoir, et pas seulement comme un être de jouissance. Son savoir est respecté comme celui d’un sujet de plein exercice, car il est sujet de plein exercice et non pas « sujet à venir », comme il est aux yeux de la pédagogie, et c’est un savoir respecté dans sa connexion à la jouissance qui l’enveloppe, qui l’anime, et dont on peut même dire qu’elle se confond avec lui.
La cure n’est pas une éducation. D’abord parce nous accueillons dans la psychanalyse des sujets traumatisés par le savoir de l’Autre, et par son désir et par sa jouissance, lesquels savoir, désir et jouissance de l’Autre ont pris, pour certains enfants, valeur de réel. Il s’agit ceux-là, oui, de les mener, mais de les mener, non pas au dux, non pas à croire au chef, mais de les mener à ceci que l’Autre n’existe pas.
C’est l’enfant, dans la psychanalyse, qui est supposé savoir, et c’est plutôt l’Autre qu’il s’agit d’éduquer, c’est à l’Autre qu’il convient d’apprendre à se tenir. Quand cet Autre est incohérent et déchiré, quand il laisse ainsi le sujet sans boussole et sans identification, il s’agit d’élucubrer avec l’enfant un savoir à sa main , à sa mesure, qui puisse lui servir. Quand l’Autre asphyxie le sujet, il s’agit avec l’enfant de le faire reculer, afin de rendre à cet enfant une respiration.
Dans tous les cas, l’analyste est du côté du sujet et c’est pour lui une tâche que d’amener le sujet, l’enfant, à jouer sa partie avec les cartes qui lui ont été distribuées. C’est ici une épreuve pour l’analyste, qui contrôle l’exactitude, la véracité de sa position d’analyste, car il ne peut opérer avec l’enfant qu’à condition de n’être serf d’aucun conformisme, et d’abord de n’être pas serf du conformisme psychanalytique, du conformisme du savoir psychanalytique.
On assiste aujourd’hui, depuis quelques années, dans un certain monde psychanalytique, à la transformation de la métaphore paternelle en standard, et ce qu’elle comporte de suprématie de la fonction du père sur le désir de la mère devient l’expression d’un machisme primaire en même temps que la castration fait figure de norme.
Le savoir du psychanalyste, ce n’est pas celui-là, c’est celui qui a à s’élucubrer au ras du symptôme, au plus près de la mise en place originelle, originale du symptôme. Ce que Lacan a appelé le sinthome, c’est un circuit de répétitions, un cycle de savoir-jouissance qui se déclenche à partir d’un événement de corps, c’est-à-dire de la percussion d’un corps par un signifiant.
Chez celui que nous appelons un enfant, on a chance de pouvoir intervenir avant que les effets d’après-coup de cette percussion n’aient pris la forme d’un cycle définitivement stabilisé, et même s’il l’est, il reste une marge qui permet encore d’orienter le cycle du sinthome, afin que le sujet puisse y trouver, sur mesure, un ordre et une sécurité.
Ce qu’il faut attendre de la prochaine Journée de l’Institut de l’Enfant, sur « L’enfant et le savoir », ce n’est pas d’élaborer, d’isoler comme une spécialité la psychanalyse d’enfant, c’est, au contraire, de contribuer au discours analytique en tant que tel.
(Transcription Daniel Roy et Hervé Damase, non relue par l’auteur)
* Présentation du thème de la deuxième Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant, prononcée le 19 mars 2011, en conclusion de la première Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant