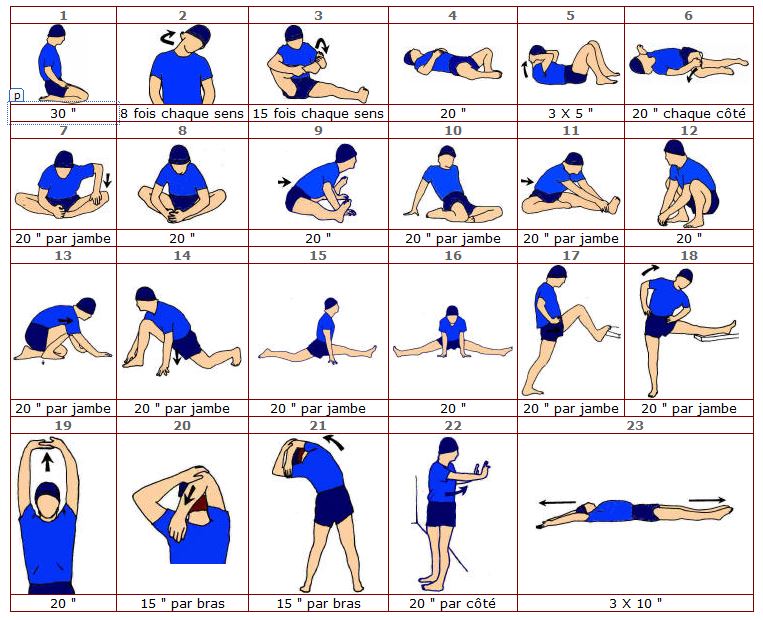Le travail clinique avec les enfants violents nous amène à poser quotidiennement la question que soulevait Jacques-Alain Miller : cette violence, à laquelle j’assiste, est-elle « sans phrase », ou est-elle « symbolisée, symbolisable »[1]Miller, J.-A., « Enfants violents », Après l’enfance, Paris, Navarin, 2017, p. 203. ?
La violence gratuite, sans pourquoi, semble-t-elle moins « réjouissante » [2]Freud S., « Pour introduire la discussion sur le suicide » (1910). Résultats, idées, problèmes. Tome I, Paris, PUF, 1998 : « Réjouissante » : la traduction du terme unerfreulich dont … Continue reading que celle qui dit quelque chose ? On soutient, chez certains sujets, une saine révolte, une crise qui fasse marchepied à une position renouvelée – une violence nécessaire, en somme.
Il n’en reste pas moins qu’accueillir la violence – même « bavarde » – dans l’institution, cela se fait a priori, avant cet après-coup qui guidera le travail institutionnel. Là, l’intervenant joue sa partie en direct et, parfois, à la manière d’un praticien du jūjutsu, l’art de la douceur auquel nous invitait Alexandre Stevens[3]Stevens A., « Devant l’enfant violent : un cadre ou un bord ? », Zappeur, n°6, décembre 2018, https://institut-enfant.fr/2018/12/03/devant-lenfant-violent-un-cadre-ou-un-bord/.
C’est en tout cas ce que l’accueil d’adolescents désignés comme violents a pu mettre en évidence dans notre travail d’enseignants au sein d’un service de pédopsychiatrie.
Il y a eu, par exemple, ce jeune à l’arrêt depuis qu’il avait découvert son père mort en rentrant de l’école et qui nous montrait sans cesse le réel auquel il avait affaire : l’impossible à symboliser du cadavre du père qui revenait au travers des images de corps affreux dont en particulier ceux de la Seconde Guerre Mondiale. Il en avait conçu une fascination pour le nazisme, faisant le salut hitlérien à chaque interpellation, gravant des croix gammées sur les murs…
L’art de la douceur suppose de sortir de la ligne de frappe, de l’axe du coup. C’est ensuite un accompagnement du mouvement qui donne, par une impulsion non contraire, une certaine destinée au geste.
Ici, ce fut de mettre de côté l’appareillage moral pour laisser passer l’agression et en faire un levier de savoir : qu’est-ce que ce jeune a à voir ? qu’est-ce qu’il a à ça-voir dans l’horreur nazie ? Lui qui s’était arrêté sur le seuil de l’Histoire, frappé par l’image décrochée de toute trame et mettant à nu quelque chose de sa vérité, a été invité à faire un pas de plus et à s’approprier une histoire. Il y a inscrit ces horreurs dans une logique, qui, toute fictionnelle qu’elle soit, a eu un effet de tempérance.
Selon un mouvement presque identique, la professeure d’art plastique s’est saisie de son goût pour la pornographie « extrême ». Elle lui a permis, dans le dessin de corps nus, de passer d’une jouissance scopique brute, sans filtre, à un regard qui se déplace dans le champ de l’esthétique.
Bien sûr, il dessine encore des petits zizis et des croix gammées au tableau, mais il les efface tout de suite et anticipe toute réaction de l’adulte en s’excusant, désabusé, d’un « Oh ! Pardon ». Le réel est là, mais l’Autre n’est pas loin.
De façon générale, nous essayons de déplacer le discours qui, jusque-là, se bornait à répéter l’interdit d’aller voir ces horreurs. Cela correspond à un « Tu peux savoir », tranchant sur le discours courant qui feint d’ignorer que ce réel est déjà là pour lui, qu’il regarde ces images ou non.
C’est une démarche de souplesse qui est au cœur de notre travail d’école en psychiatrie, en tant qu’elle place le savoir culturel comme outil tampon à la crudité du réel et permet ainsi de construire des défenses – peut-être même des self-défenses.
Pascal Docquiert
Notes[+]
| ↑1 | Miller, J.-A., « Enfants violents », Après l’enfance, Paris, Navarin, 2017, p. 203. |
|---|---|
| ↑2 | Freud S., « Pour introduire la discussion sur le suicide » (1910). Résultats, idées, problèmes. Tome I, Paris, PUF, 1998 : « Réjouissante » : la traduction du terme unerfreulich dont Freud désigne certains stades auxquels s’attarde l’enfant dans son développement. |
| ↑3 | Stevens A., « Devant l’enfant violent : un cadre ou un bord ? », Zappeur, n°6, décembre 2018, https://institut-enfant.fr/2018/12/03/devant-lenfant-violent-un-cadre-ou-un-bord/ |