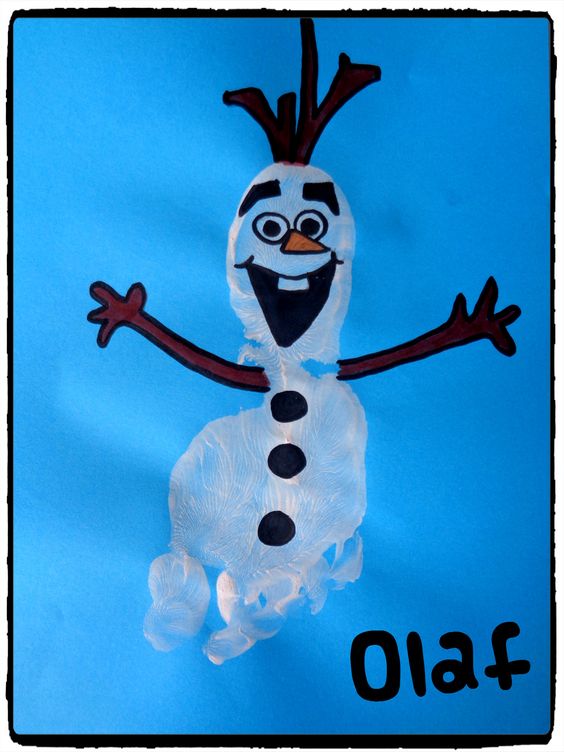Loin d’un illusoire « monde des bisounours », la pratique auprès des tout-petits nous met devant la radicalité de la façon dont l’enfant se trouve « pris dans le jeu entre énoncé et énonciation »[1]Miller J.-A., « Interpréter l’enfant », Le Savoir de l’enfant, Paris, Navarin, coll. La Petite Girafe, 2013, p. 22., à savoir, la façon dont il est parlé par l’Autre. L’enfant en tant que « jeune sujet »[2]Lacan J., Le Séminaire, livre v, Les Formations de l’inconscient, Paris, Seuil, 1998, p. 89. serait ainsi ce parlêtre en devenir, qui apparaît et disparaît dans les plis du discours qui le porte – celui de ses parents – et qui lui fait une place dans le monde du signifiant.
Il arrive que l’enfant réponde à cette expérience par une impasse. Il arrive aussi qu’il tente de s’en affranchir par une sortie du discours, par exemple lorsqu’il mord ! La violence soudaine de ce geste se voit redoublée du fait de l’incompréhension des adultes qui la plupart du temps assistent médusés à des telles scènes. Tout appel à la raison de l’enfant s’avère vain car il arrive trop tard. Punitions, sermons, négociations et autres conséquences ne sont que l’aveu d’impuissance devant la sidération produite lorsque l’enfant mord.
Il s’agit en effet d’un motif fréquent de consultation. Que l’enfant morde ses proches (parents, frères et sœurs, etc.) ou qu’il morde à la crèche, la demande de l’Autre est dans ces cas pressante.
Une jeune mère s’adressait ainsi à l’analyste : « Mon fils mord les autres enfants à la crèche… tous les jours. On a tout essayé, rien ne marche. Il faut que ça s’arrête ! ». Au bout de sa peine, elle avouait en pleurs « raser les murs » chaque matin en allant déposer son enfant. Son fils était devenu « un mordeur en série ». Regarder en face les parents de la longue liste d’enfants mordus devenait pour elle insoutenable. Son fils, âgé de deux ans et demi, ne pouvait rien en dire.
Suite à quelques séances, cette femme a fini par repérer un détail qu’elle transmet en présence de son fils : après avoir mordu un autre enfant, il se met à pleurer de façon « inconsolable ». Là où le signifiant « mordre » rendait l’enfant muet et son entourage perplexe, un autre signifiant inaugurait une nouvelle brèche. L’analyste a pu s’adresser à l’enfant en lui disant très doucement « Eh oui ! Mordre te fait pleurer… ». Cela a permis à la mère d’entendre que derrière le mordeur en série apparaissait la tristesse de son fils qui avait perdu peu de temps auparavant le statut privilégié d’être le seul enfant de la famille. Un petit frère était né quatre mois plus tôt ; devant cet intrus inopiné, l’enfant devenu frère-aîné se défendait littéralement bec et ongles contre l’ensemble de ses semblables.
Une autre mère se dit « au bout du rouleau » : sa fille de trois ans fait des grosses colères à la maison. Lors de ces batailles épuisantes, l’enfant peut aller « jusqu’à [la] mordre », dira la mère. Pendant ce temps, tout en gardant un silence hermétique, l’enfant ne perd pas une miette de ce que dit sa mère. Cette petite fille a rapidement indiqué à l’analyste le chantier à mettre en place ; tout ou presque tenait à sa demande de séparer quelque chose : mettre des barrières, couper des feuilles en deux, extraire des bouts d’un gros morceau de pâte à modeler afin de fabriquer des boules distinctes, etc. Me faisant l’instrument de ces actes de coupure, je m’y prêtais, sans plus. C’est durant l’une de ces séquences qu’un jour elle me dit : « Je mords… je mords quand on me gronde ». À ma question : « Qui te gronde ? », elle répond : « mes parents et mes frères ». Et ils te grondent souvent ? « Oui », répond-elle. « Et tu les mords souvent aussi ? » « Oui », admet-elle. Je lui dis : « Ah, quand tu mords, tu es peut-être très en colère, et quand tu mords tu ne peux pas parler ». Au fur et à mesure de nos rencontres, le noyau logique de ces épisodes où elle mordait sa mère s’est avéré comme l’indice d’une tentative – vouée à l’échec – pour résoudre un choix subjectif difficile : rester « le bébé » et combler ainsi ad vitam aeternam le manque maternel ou s’avancer sur son désir de grandir.
La norme sociale peut fixer l’enfant qui mord au statut d’enfant violent. À contre-courant, le psychanalyste fait une place à l’énigme du jeune sujet, qui se débat et demande à être entendu.
Beatriz Gonzalez-Renou