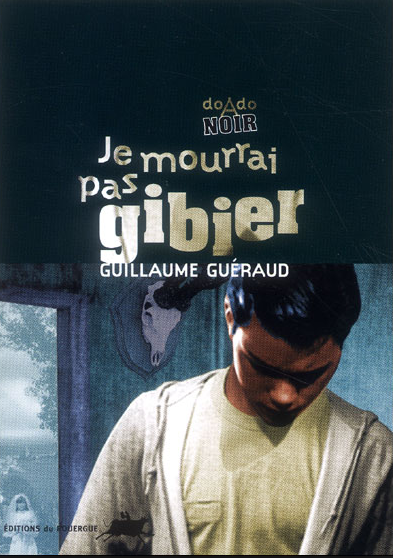Le roman de Guillaume Guéraud, Je mourrai pas gibier[1]Guéraud G., Je mourrai pas gibier, Éditions du Rouergue, 2006., paru en 2006, a fait date dans la littérature de jeunesse pour la violence extrême dont il fait le récit. Il retrace la logique qui conduit un adolescent livré aux énoncés de haine des autres à un acte de violence. La parole ne s’offre plus comme ressort efficace pour faire valoir son être : « Ne savons-nous pas qu’aux confins où la parole se démet, commence le domaine de la violence, et qu’elle y règne déjà, même sans qu’on l’y provoque ? ». Ce propos de Lacan, cité par Miquel Bassols dans son article « Acte de violence »[2]Bassols M., « Acte de violence », Zappeur, n°4, trad. par Valéria Sommer et Victor Rodriguez, institut-enfant.fr/2018/10/07/acte-de-violence/, s’offre comme une boussole dans notre lecture de ce roman.
Le village de Mortagne est depuis toujours structuré par une série d’énoncés qui assignent chacun à une place : on travaille soit dans la vigne, soit dans le bois. Chaque clan hait l’autre : « La haine ne divisait ordinairement pas les scieurs, au contraire, elle leur servait de ciment car elle ne visait que les vignerons. »[3]Guéraud G., Je mourrai pas gibier, op. cit., p. 19. Tous les hommes partagent néanmoins un même trait : tous chasseurs. C’est une question de survie, comme le prescrit le mot d’ordre du village : « Je suis né chasseur ! Je mourrai pas gibier ! ». Si je ne tue pas, je serai tué. Le lien social est réduit à la pure rivalité imaginaire.
Martial, adolescent, fait partie des gens du bois : dans sa famille, on travaille tous à la scierie. On attend de lui qu’il suive le même chemin. Il choisit un mode singulier d’inscription dans l’Autre, en faisant son stage chez un luthier, « pour aller voir ailleurs », « simplement par curiosité »[4]Ibid., p. 23.. Seulement, Frédo, un ami de son grand frère, lui lance avec haine : luthier, « c’est un métier de pédé ! » L’insulte a un effet ravageur. Martial arrête tout, le stage, le lycée, le bois, et s’inscrit en mécanique : « Histoire de faire chier tout le monde sans faire dans la dentelle. »[5]Ibid., p. 25.
Cette décision a pour effet de l’éloigner de son village : son lycée est loin, il passe la semaine à l’internat et rentre le week-end. Sur le chemin de la maison, il croise chaque vendredi soir, à l’arrêt de bus, un autre esseulé, Terence, un simple d’esprit, un « pleu-pleu ». C’est l’idiot du village. Ni du bois, ni de la vigne, ni chasseur, il est un vagabond insituable. Alors, Martial commence à sympathiser avec lui. Et, à force de faire chaque semaine un bout de chemin ensemble, une rencontre a lieu entre ces deux solitudes. Sauf qu’un jour, Terence n’est pas au rendez-vous.
Le lecteur sait d’emblée que ça se termine mal car le roman s’ouvre par l’arrivée des gendarmes sur une scène de massacre. Martial, après avoir constaté la mort de Terence, retourne à la maison familiale. Ce jour-là on fête le mariage de son frère. Il saisit une carabine et, depuis la fenêtre de la chambre de ses parents, tire dans le tas, pour « balayer Mortagne de la surface de la Terre »[6]Ibid., p. 61..
Dans ce récit, la violence est physique et symbolique : le massacre commis par Martial, Terence retrouvé défiguré, la violence d’un discours, l’appel à la haine.Les insultes, les assignations pleuvent. Qui refuse de s’y plier n’a d’autre choix que de partir. Face à l’insupportable, Martial choisit le passage à l’acte : le sujet bascule hors scène et se réduit à un « je ne pense pas »[7]Lacan J., « Compte-rendu de la logique du fantasme », Ornicar ?, n° 29, Paris, 1984, p. 14.. Son être ne trouvant nulle reconnaissance dans l’Autre, il s’en va et « part à la recherche, à la rencontre, de quelque chose de rejeté, de refusé partout. »[8]Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 137. Là où le lien social organisé par la seule haine empêche l’expression de toute singularité, il reste alors l’imaginaire de la rivalité, qui précipite Martial dans l’impasse d’un « Si c’est pas toi, c’est moi ». À la fin, il ne reste que lui.
Martial aurait pu choisir de partir ou de dénoncer le meurtre de Terence. Mais il ne prend pas la parole. Il passe à l’acte. Il se trouve finalement, à son tour, joué par les énoncés que pourtant il dénonce, puisqu’il réalise la sentence : « Je mourrai pas gibier ».
Dominique Corpelet
Notes[+]
| ↑1 | Guéraud G., Je mourrai pas gibier, Éditions du Rouergue, 2006. |
|---|---|
| ↑2 | Bassols M., « Acte de violence », Zappeur, n°4, trad. par Valéria Sommer et Victor Rodriguez, institut-enfant.fr/2018/10/07/acte-de-violence/ |
| ↑3 | Guéraud G., Je mourrai pas gibier, op. cit., p. 19. |
| ↑4 | Ibid., p. 23. |
| ↑5 | Ibid., p. 25. |
| ↑6 | Ibid., p. 61. |
| ↑7 | Lacan J., « Compte-rendu de la logique du fantasme », Ornicar ?, n° 29, Paris, 1984, p. 14. |
| ↑8 | Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 137. |