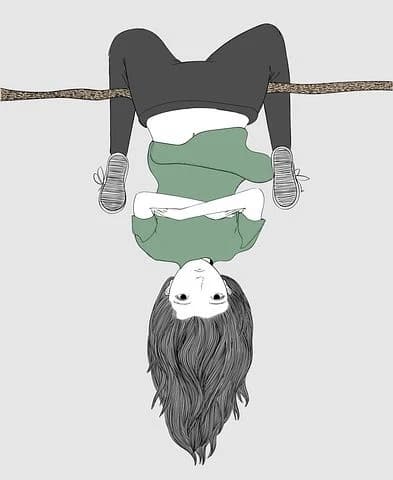Par Marie-Cécile Marty
« Un savoir donc, se réfugie quelque part par rapport à quoi tout savoir s’institue dans une horreur indépassable, au regard de ce lieu où gît le secret du sexe. [1]»
Dans son célèbre roman Lolita paru en 1955, Vladimir Nabokov a l’art de semer le trouble chez le lecteur et de le laisser intranquille. Dans ce roman, « le désir pervers se livre[2] ». Le lecteur est convoqué dans ses défenses intimes : comment recevoir les faits exposés et prendre position ? Le lecteur se laissera-t-il séduire par Humbert Humbert, le narrateur âgé de quarante ans, exposant sa passion et le drame de son obsession pour les nymphettes ? Le lecteur se laissera-il troubler par le menu détail érotisé du tableau que l’homme de lettres et amateur d’art dresse de Lolita, douze ans ? Consentira-t-il à ce regard porté sur l’enfant ? Le lecteur se laissera-t-il emporter et fasciner par l’art de l’écriture dévoilant le fantasme ? Le lecteur se laissera-t-il désorienter par l’aveu de pensées tortueuses et torturées du narrateur à son tribunal intérieur ? Dans le roman, un contraste : le silence de Lolita. Il est la marque de la rencontre avec le réel. Ce silence ne saurait être trop vite interprété. Dans son enseignement, Lacan apporte un point d’orientation précieux : « le réel ne saurait s’inscrire que d’une impasse de formalisation [3]». Dans la rencontre avec le sexuel, qui est par essence troumatique, irreprésentable, la faille de l’indicible est béante.
La psychanalyse fait un accueil attentif au sujet, qui dans l’après coup de cette mauvaise rencontre, tente d’attraper avec les mots ce « jusqu’au plus intime de l’organisme […] qui fait réel et qui est vraiment sur le pourtour [4] », et qui rate à se saisir.
Dans son livre Le Consentement, Vanessa Springora témoigne combien ce chemin a été long et délicat – jonché de moments au bord du gouffre – pour trouver la voie pour dire sans obscénité.
Le législateur se trouve interpellé : que fait la justice ? Les textes de loi essaient d’attraper ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. L’acte de juger est complexe. Il implique « l’intime conviction » précise le texte de la loi, dans lequel ne figure pas le terme de vérité. Comme l’indique Lacan, la vérité ne peut pas se dire toute. Il ajoute que chacun est amené à l’attraper par le prisme de son fantasme ; la vérité est alors menteuse.
La justice pénale traite de ce qui fait la complexité de l’humain : elle juge les transgressions sexuelles. Et, elle est dépositaire à ce titre, de ce qui se dit de ce qui s’éprouve de plus intime dans un corps et des passions.
Après avoir introduit le terme « inceste » dans ses textes, elle introduit ceux de « consentement » et « discernement ». Avec ces termes, elle tenterait d’introduire une prise en compte de la dimension de la capacité et de la liberté de choix chez les enfants, tout en le considérant comme un sujet à protéger par principe. À l’heure où les jouissances privées s’exposent au grand public notamment sur la toile, d’un côté l’enfant exposé est plus que jamais à protéger, et de l’autre, il est à entendre dans les choix – par exemple de genre – qu’il s’autorise parfois très tôt. Comment les textes de loi se débrouillent de ces trois termes mal assortis : consentement-discernement-protection ? Ils introduisent des seuils d’âge.
À l’époque du contrat d’objectifs qui accompagne le projet de vie de l’enfant où « consentement » et « autonomie » sont des signifiants maître, les théories neuro-développementales sur les stades d’acquisitions se proposeraient-elles comme prêt-à-penser au maître moderne qui rêve d’efficacité et d’une parole sans malentendu ? Les stades d’acquisition ne sauraient servir à dire ce qu’est le développement psychique de l’enfant tant il est complexe, car constitué, souligne Freud, d’un « assemblage de différentes sources [5]», avec des moments de fixations, de déplacements, de remaniements et comporte, au-delà des métamorphoses de la puberté, une part d’inachevé. Par ailleurs, les signifiants maîtres « consentement » et « autonomie » laissent l’enfant ou l’adolescent Un tout seul aux prises avec les questions de motivation, d’intention, de volonté, qui ont des affinités avec un surmoi féroce. Or, le consentement n’est pas un « oui volontaire et univoque, émanant de quelque sujet autonome [6]».
*Après coup d’une soirée de l’Atelier de recherche de l’IE à Lyon, à partir de la présentation de la lecture de Lolita de V. Nabokov par Natacha Billouard, psychologue – groupe « Petit Hans » et J‑M. Fayol-Noireterre, magistrat honoraire – CIEN à Lyon.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XII, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », leçon du 12 mai 1965, inédit.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La Martinière, 2013, p. 537.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 85.
[4] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Être et l’Un », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 9 mars 2011, inédit.
[5] Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, 1987, p. 93.
[6] C. Alberti, « Liminaire », Ornicar ?, n°54, Consentir, Paris, Champ freudien, 2020, p. 5.