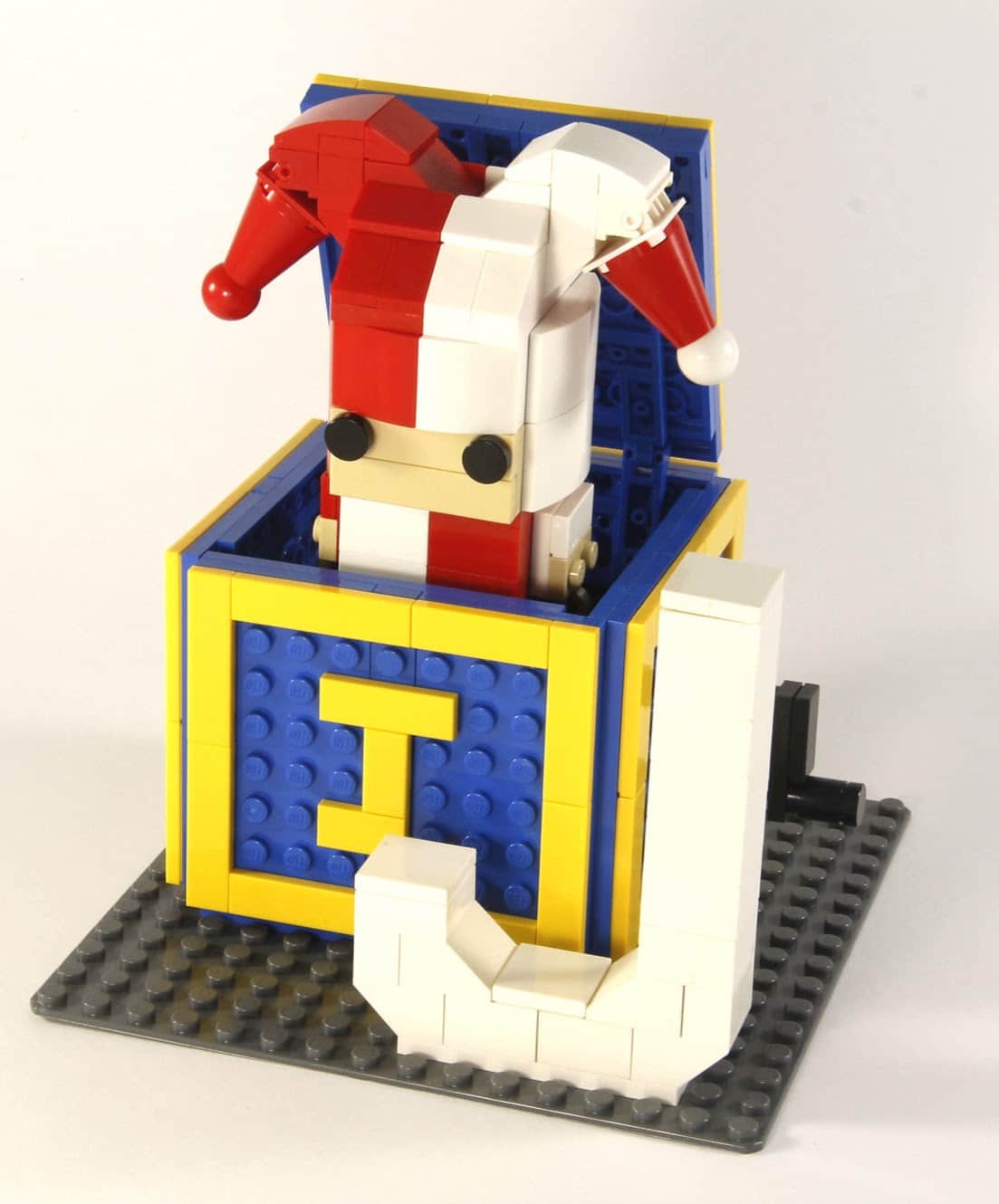par Aurélie-Flore Pascal
Si l’orthographe est codifiée, et susceptible d’être enseignée, corrigée, si l’articulation fait l’objet de règles et peut être rééduquée à l’occasion, la sexuation est marquée d’une faille dans le savoir. Pour se positionner dans le répartitoire sexuel, un enfant ne peut s’appuyer sur une règle qui vaudrait pour tous. Alors, lorsqu’un enfant est adressé avec une demande rééducative et, parce qu’il y a rencontre du côté de l’analyse, se lance dans une partie où « on joue un jeu dont on ne connaît pas les règles [1]», c’est une surprise, ça remue et orthographe, phonétique et lalangue dialoguent.
C’est toujours une surprise quand une telle rencontre advient, du côté de l’enfant, mais aussi de mon côté, en tant que praticienne. Le passage de l’orthophonie à la psychanalyse s’est fait pour moi lorsque j’ai pu éprouver que la pratique ortho butait sur un os, celui de la jouissance, jouissance sur laquelle les protocoles de rééducation n’ont pas de prise. Question qui nous intéresse d’autant plus que « le sexuel ne trace pas de sillon de la différence dans le champ symbolique, la différence ne s’opère que dans le champ de la jouissance [2]» nous enseigne Daniel Roy, ce qui nous oriente, c’est le symptôme.
Une petite fille m’est adressée parce qu’elle confond les lettres b et d. Un classique, pourrait-on dire, en orthophonie. Ce qui n’était pas du tout classique, dans le cas de cette petite fille, c’est qu’elle faisait un usage de la lettre bien particulier et se signalait par là comme ne faisant pas partie de la famille de littéraires à laquelle elle appartenait. Tout en se défendant de cette loi familiale assez féroce, elle avait trouvé à se servir de la lettre non pas de manière littéraire mais littérale. Entre les deux phonèmes [b] et [d], la différence est mince : il n’y a qu’un seul trait phonétique qui les différencie, (le lieu d’articulation). C’est ce qu’on appelle une paire minimale. Pour cette patiente, il s’agissait de cultiver cette petite différence dans cette manière symptomatique de se positionner avec l’Autre. Loin de toucher au symptôme, je tentai de rester au plus près de sa subjectivité, « le savoir du psychanalyste […] c’est celui qui a à s’élucubrer au ras du symptôme [3]». Elle m’amena sur le terrain du jeu dont les règles étaient inventées par elle. Des jeux de lettres, où la jouissance de lalangue se faisait entendre, « le bavardage des enfants, auxquels il est souvent demandé de se taire pour apprendre, prend-il sa source dans la position sexuée qui consiste à jouir de la parole [4]» écrivent Laura Sokolowsky et Hervé Damase dans l’argument de la prochaine Journée de l’Institut de l’Enfant. En effet, là où les concepts de dyslexie et de dysorthographie peuvent jeter un voile sur la division du sujet, c’est plutôt sur la modalité de jouissance propre de cette petite patiente, que j’ai parié. On s’est mises alors à jouer le jeu, et comme le dit bien Lacan, « on ne jouljeut qu’au singulier […] ça ne se “conjeugue” pas au pluriel, le jouljeu [5]». Ce n’est pas sans le partenaire analyste, mais c’est à partir de sa solitude propre que les règles s’inventent, à partir de l’Un de jouissance, de son rapport à lalangue qui n’est pas pluralisable, comme nous l’enseigne Lacan.
En séance, elle change les règles de certains jeux, prenant appui sur ses propres signifiants, faisant ressortir le versant jouissance de ses productions langagières. Elle s’amuse en intervertissant le b et d, joue avec la matière sonore, au-delà du sens. Toujours par le truchement du jeu et de l’écrit, elle rédige des règles pour me faire faire des gages. Je ne m’y plie pas toujours, prétextant parfois que c’est bien trop difficile ou que je suis fatiguée etc. J’accueille ce qu’elle produit et le lis à partir d’une Clinique ironique[6] au sens où ce qui compte c’est la jouissance, l’Autre est un semblant. Elle s’en amuse beaucoup, teste les limites, cherche s’il y a une raison à mes acceptations ou mes refus et me demande qu’on échange les rôles. Avoir affaire à un Autre qui peut supporter la castration, c’est-à-dire qui peut se montrer pas complet, manquant, lui permet de mettre au travail de nouvelles questions – dont celle du manque – sa position sexuée se construisant peu à peu.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 12 mars 1974, inédit.
[2] Daniel Roy, « Une différence, des différences », conférence lors de la soirée clinique du Forda « Fille, Garçon, Ça sert ? Ça serre ? La différence sexuelle dans la clinique avec les enfants », Paris, 28 novembre 2019, inédite.
[3] Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », La petite girafe, Volume 1, Peurs d’enfants, Navarin éditeur, 2011, p. 19.
[4] Sokolowsky L., Damase H., argument de la JIE6, Zappeur du 12 février 2020.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 19 février 1974, inédit.
[6] Cf. Miller J.-A., « Clinique ironique », Revue de la Cause freudienne no 23, février 1993.