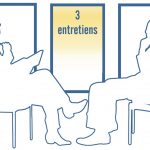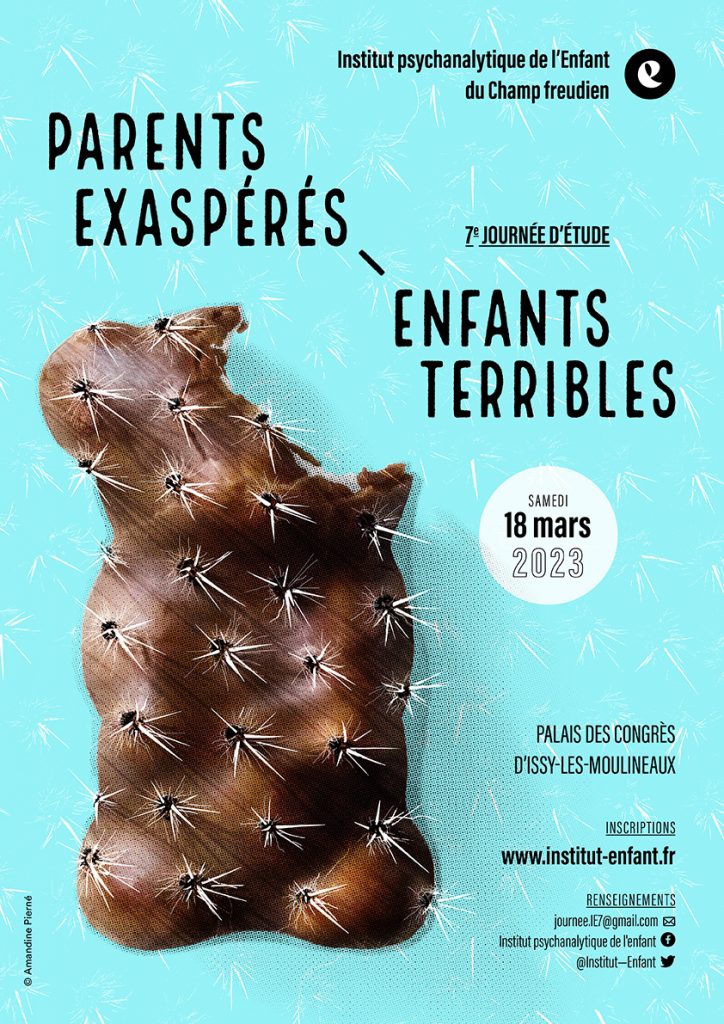Le film récent de Nanni Moretti, Tre piani, explore la question de la famille, de la paternité, de la maternité, de l’enfant. Une scène retient l’attention pour ce qu’elle révèle de vérité. Un adolescent a commis l’irréparable : un accident de voiture sous l’empire de l’alcool a entraîné la mort d’une femme. On comprend que cet enfant a toujours posé problème. À un moment du film, aux prises avec ses parents, tous les deux magistrats, il les interpelle durement en leur demandant ce qu’ils ont fait de sa façon de vivre à lui. Il est vrai que dans une famille, quand l’enfant y paraît, il a déjà très tôt sa façon de vivre, his way, on pourrait dire son mode de jouir. La chose est méconnue et pourtant la famille n’est pas qu’affaire de lois et de règles[1].
Famille et transmission
Le texte d’orientation de Daniel Roy, « Parents exaspérés – enfants terribles », n’aborde pas la question de la famille par sa face symbolique, comme cela est souvent pris, mais par une interrogation posée par Lacan en 1976 : « Est-il oui ou non fondé ce rapport de l’enfant aux parents ?[2] ». Cette question ouvre des perspectives concernant le caractère réel des rapports parents-enfants. En un autre temps, elle aurait été considérée comme incongrue, parce que la structure symbolique de la famille était une donnée première, elle existait préalablement comme réponse « naturelle » au problème de la transmission.
Cette interrogation de Lacan à la fin de son enseignement permet d’appréhender en quoi le symbolique a longtemps été considéré comme le « naturel » de la religion, ce que la fin du XIXe siècle est venu déconstruire et dénuder. Cette collusion de naturel et de symbolique s’est aperçue lors des mouvements à propos de la loi sur le mariage pour tous : certains religieux et certains lacaniens se donnant la main pour dire non à ce mariage pour tous, au nom de la nature des choses pour les uns et du symbolique pour les autres. Pourtant Freud, puis Lacan – dès « Les complexes familiaux…[3]» – constatent un dérèglement du symbolique : la famille est loin d’être naturelle, car elle ne tient que par l’efficace du symbolique, dont la figure principale, celle du père, décline, s’évapore[4] – ce dont Lacan n’est pas nostalgique. Notons qu’aujourd’hui, les signifiants père et mère sont remplacés par celui de parent.
Aussi, poser cette question du lien de l’enfant aux parents revient à se demander ce qui fonde réellement, et non uniquement symboliquement, un lien de parenté. Lacan, dans ses premiers Séminaires, révèle l’algorithme qui anime la famille et le formalise ainsi : Le désir de l’homme, c’est le désir de l’Autre.
On peut donc dire que le déclin du patriarcat est allé de pair avec la mise en avant du désir, désir qui dépend de celui de l’Autre, désir que l’Autre transmet en toute inconscience, à son insu dans une bévue – nous y reviendrons. Finalement, c’est la transmission qui est un réel, un « résidu » pour le dire avec les mots de Lacan dans « Les complexes familiaux[5] » et dans sa « Note sur l’enfant[6] ». La famille, elle, varie. En effet, en 1969, au moment où sont tentées des vies communautaires utopiques – c’est-à-dire des alternatives à la famille dont on veut la disparition –, Lacan écrit : « La fonction de résidu que soutient (et du même coup maintient) la famille conjugale dans l’évolution des sociétés, met en valeur l’irréductible d’une transmission […] qui est d’une constitution subjective, impliquant la relation à un désir qui ne soit pas anonyme[7] ».
Le réel n’attend pas
« Le réel n’attend pas, et nommément pas le sujet, puisqu’il n’attend rien de la parole. Mais il est là, identique à son existence, bruit où l’on peut tout entendre, et prêt à submerger de ses éclats ce que le “principe de réalité” y construit sous le nom de monde extérieur[8] ».
Cette phrase rend compte de ce qui se passe dans une pratique de la psychanalyse auprès d’enfants et en institution. Le sujet dont parle Lacan, sujet de l’inconscient, n’est pas premier. Ce qui existe, qui est premier, c’est un réel, un symptôme qui se présente sous sa face réelle qui fait signe et non signifiant, dans une certaine urgence dont témoignent les moments de crise faits de bruit et d’éclats, productions hautement humaines. Donc à la fois ça urge, on n’attend pas pour recevoir, et en même temps le sujet de l’inconscient n’est pas constitué : il faut le faire advenir. Comment ? Par l’interprétation, pas par le transfert. Lorsque l’analyste rencontre un enfant pour la première fois, parfois avec ses parents ou son parent, les bruits et les éclats qui nous sont rapportés témoignent d’un réel de la jouissance de chacun. En effet, ils ne viennent pas porteurs d’une plainte en bonne et due forme, rédigée, articulée, argumentée. Les choses ne sont même pas structurées selon les termes d’un conflit. C’est avec la rencontre avec un analyste qu’une articulation de ce que chacun rencontre commence.
L’enfant aujourd’hui
L’enfant d’aujourd’hui est un enfant seul, confronté à une solitude, subissant en cela l’individualisme de notre époque. Le témoignage de cette solitude se traduit par la plainte souvent émise de l’ennui, porte de l’angoisse. Les femmes sont seules aussi, souvent en charge d’enfants, sollicitées d’un côté par le travail et de l’autre pas la chose domestique : c’est ici qu’est née ladite « charge mentale ». Il existe dorénavant toute une industrie de la procréation. Cette industrie a fait monter au zénith l’idée de « l’enfant zéro défaut[9] », comme l’indique Éric Laurent, qui correspond rarement à la réalité à laquelle se heurte le désir des parents qui les pousse à procréer. Cela les met parfois dans une position de demander qu’on le leur répare. C’est parfois à l’occasion des premiers entretiens qu’ils mesurent en parlant le coût subjectif d’avoir voulu un enfant : il y a là un processus qui se réalise ou pas, s’accompagne ou pas. L’enfant d’aujourd’hui fait la composition ou la recomposition de la famille. Mais lorsque l’enfant est ainsi situé comme un objet avec tous ces défauts, faire famille ne devient pas vraiment désirable.
Faire famille, ou jouir
Mesurons la conséquence importante de cette primauté de la jouissance. Ce réel au principe même de la famille a pour conséquence « que “famille” n’est plus un signifiant donné à l’avance en tant qu’inscrit dans le symbolique, que ce soit par la filiation ou par l’alliance. Cette inscription est la part qui revient à chacun des parlêtres, en tant qu’il fait ou non exister la fonction signifiante de la famille là où s’impose sa fonction de jouissance, cette disjonction faisant souvent venir au premier plan la fonction imaginaire de la famille[10]».
Ceci signifie qu’aujourd’hui chacun des parlêtres qui vit sous le même toit est divisé entre faire vivre la famille par la parole et se vouer à sa jouissance propre. Cette alternative montre que la famille n’est plus une donnée première : à l’instar de faire couple, on fait famille. Cela participe d’un mouvement plus général que Jacques-Alain Miller et Éric Laurent ont abordé dans un cours de l’orientation lacanienne sous l’accent de « L’Autre qui n’existe pas[11],» il faut ajouter : « préalablement ».
Ce n’est pas parce qu’il y a des enfants et des parents qu’une famille existe, ce que l’on constate fréquemment dans certaines institutions où la famille comme formation humaine n’est pas là pour « réfréner la jouissance[12]». Le dernier livre de Christine Angot, Voyage dans l’Est, l’illustre, lorsqu’elle demande à celui dont elle veut qu’il soit son père, afin d’être sa fille, de ne pas abuser d’elle ce weekend. Ce à quoi il ne consent pas, refusant par-là qu’elle soit sa fille[13].
L’angoisse et l’objet
C’est dans l’écart entre le désir de faire famille et le fait de jouir que se loge, nous dit D. Roy, la fonction imaginaire de la famille, point d’appel du coaching de tout poil : rabattement des vertus de la transcendance signifiante sur le comportement et réduction de l’enfant à son cerveau, à sa cognition. Il écrit : « Se trouve ainsi occulté, dans cette zone d’aliénation signifiante, ce qui circule comme désir et ce qui se dépose de jouissance en jeu, pour chacun des partenaires. C’est en effet sur cette intersection que se fonde le moindre processus de séparation. […] Il y va de la possibilité pour un enfant de déchiffrer les coordonnées de la place qu’il occupe pour ses parents comme “cause de leur désir” et comme “déchet de leurs jouissances”[14]».
Roy fait ainsi valoir une fonction de l’objet que l’on peut aussi bien aborder sous l’angle du Fort/Da que sous celui de l’angoisse. L’objet quand on parle est toujours en rapport au manque. C’est l’objet qui cause, à entendre dans son équivoque : on veut dire, on dit, il reste à dire donc on dit à nouveau. L’existence n’est rien d’autre qu’une conversation continue. Il arrive souvent dans la conversation avec les autres de l’enfant qu’un élément ne soit pas aperçu : il s’agit de l’angoisse, qui est cette autre approche de l’objet. L’enfant se trouve dans l’angoisse, dans la terre, comme le signale D. Roy : « la terreur » est terrorisée. Les peurs d’enfants sont régulièrement occultées. D’abord par la phobie, comme dans le cas Hans, mais celle-ci peut prendre différentes formes, dont celle de ces adolescents qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Peut-être ici faudrait-il faire une clinique différentielle entre la phobie comme plaque tournante de la névrose et les errances psychotiques qui trouvent à se loger sous le toit familial ou à se fixer par un toxique, parfois les deux.
Alors, chiffonner les mots a son importance. Par exemple pour les mots « drogue » ou « religion », cela permet de les déminer, de les délibidinaliser, car ce sont des mots qui sont davantage en connexion avec le corps. « Ça consiste à se servir d’un mot pour un autre usage que celui pour lequel il est fait, on le chiffonne un peu, et c’est dans ce chiffonnage que réside son effet opératoire[15]». Parfois, il s’agit de passer par d’autres ressorts de la langue qui consent aux opérations de la métaphore et de métonymie, comme le fait Hans. Ce sont deux orientations proposées par D. Roy.
L’objet dont il s’agit dans l’expérience analytique est un objet immatériel et pourtant bien réel, alors que les objets de la consommation ont une réalité, mais demeurent très virtuels. Cet objet ne se situe pas dans le champ de l’utilité, dans le champ physique. Et chez l’être humain, si cela ne se situe pas dans le champ de l’utilité, cela a donc à voir avec le champ de la jouissance. Il y a beaucoup d’objets humains dans ce champ. Un beau tableau, par exemple, est le truchement par lequel vous surgissez comme objet, où vous êtes un regard. Notons au passage le fait qu’il faut articuler l’objet au verbe être et non pas seulement au verbe avoir. Et Lacan, dans L’Angoisse dit ceci : « Là où vous dites je, c’est là, à proprement parler, que, au niveau de l’inconscient, se situe a. À ce niveau, vous êtes a l’objet, et chacun sait que c’est ce qui est intolérable[16] ». C’est supportable dans le cadre apaisant d’une expérience esthétique ou dans l’amour. Mais dans d’autres situations, comme celle de l’enfant, être un objet, un objet qui n’est pas précieux ou qui l’est trop, un objet à réparer, laissé tomber ou jamais lâché, c’est intolérable. C’est pourtant le statut primitif de l’enfant comme objet pouvant venir saturer le fantasme de la mère : l’enfant doudou.
Donc concernant l’objet dans ses rapports à l’avoir et à l’être, Lacan ne dit pas que l’angoisse a un objet, il dit : « l’angoisse […] n’est pas sans objet[17]». Ce qu’il faut entendre c’est : l’angoisse n’a pas d’objet extérieur comme la peur ou la phobie. L’angoisse concerne l’être du sujet et se manifeste quand il rejoint son statut d’objet, quand corps et parlant se dénouent.
La bévue contre la norme
Le texte d’orientation se clôt sur une proposition : substituer au paradigme du dysfonctionnement, de l’erreur et du trouble, la notion de bévue, d’une-bévue, que Lacan introduit à la fin de son enseignement. D. Roy lui donne un formidable empan. Il ne s’agit pas de pinailler si ceci ou cela est un acte manqué ou un trouble dys. Il s’agit de considérer que l’expérience humaine se meut tout entière dans la bévue. Que trouble, dysfonctionnement, erreur n’existent que parce que des normes existent. Ces normes sont récentes, comme l’indique Lacan dans …ou pire : « Si la notion de normal n’avait pas pris pareille extension à la suite des accidents de l’histoire, l’analyse n’aurait jamais vu le jour. (…) Il n’y a pas de trace du mot norme nulle part dans le discours antique. (…) Il faut quand même partir de là pour voir que le discours de l’analyse n’est pas apparu par hasard. Il fallait qu’on en soit au dernier état d’extrême urgence pour que ça sorte[18]». Il y a donc une responsabilité du psychanalyste à se défaire des productions de la psychologie, cette grande façonneuse de l’idéologie du moi moderne qui convient à la science et au capitalisme réunis, afin de retrouver le soc tranchant de la découverte freudienne : celle de l’Unbewusst qui se traduit par « inconscient », « bévue », qui joue sa partie avec la vérité et le réel et non avec la norme.
Cela relève d’une position éthique du praticien et, en dernière analyse, du désir de l’analyste, informé que la bévue et le bafouillage[19] caractérisent fondamentalement la condition humaine. Pourquoi ? Du fait de ces deux parasites que sont le langage et la jouissance. Dans le cabinet de l’analyste, en séance, dans une institution, c’est l’espace de la bévue qu’il faut ouvrir et préserver. Cette nouvelle définition de l’inconscient par Lacan va de pair avec le nouveau nom qu’il donne au sujet dans ces années-là : le sujet est corps parlant. Voyez comme l’enfant dans sa vie quotidienne, en certains lieux, n’est que corps : agité et donc à discipliner. Combien l’idée de lui parler, de s’adresser à lui, de lui donner la parole est loin d’être évidente. L’analyste trouve ici sa place : accueillir le corps parlant, accuser réception de la bévue avec respect. Mais aussi, de la bonne manière, par l’interprétation, indiquer « à l’Autre qu’il convient d’apprendre à se tenir. Quand cet Autre est incohérent et déchiré, quand il laisse le sujet sans boussole et sans identification[20]».
[*] Zuliani É, conférence du 18 octobre 2021 à Nantes dans le cadre des activités du Centre d’Étude et de Recherche sur l’Enfant dans le Discours Analytique.
[1] Paragraphe ajouté le 10 septembre 2022.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’Une bévue s’aile à mourre », leçon du 14 décembre 1976, Ornicar ?, n°12/13, décembre 1977, p. 14.
[3] Lacan J., « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p 23.
[4] Lacan J., « Note sur le père », La cause du désir, n°89, janvier 2015, p. 8.
[5] Lacan J., « Les complexes familiaux… » op. cit.
[6] Lacan J, « Note sur l’enfant », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p. 373.
[7] Lacan J., Ibid.
[8] Lacan J., « Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 388.
[9] Laurent É., « Cómo criar a los niños », 2008, disponible sur internet.
[10] Roy D., « Parents exaspérés – Enfants terribles », Texte d’orientation des 7e journées de l’Institut psychanalytiques de l’enfant, disponible sur internet.
[11] Miller J.-A., Laurent É., « L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthiques », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, 1996–1997, inédit.
[12] Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p 364.
[13] Christine Angot, Voyage dans l’Est, Flammarion, 2021, p. 180.
[14] Roy D., « Parents exaspérés – Enfants terribles », op. cit.
[15] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’Une Bévue s’aile à mourre », op. cit, p. 21.
[16] Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, texte établi par J.-A. Miller, p. 122–123.
[17] Ibid, p. 185.
[18] Lacan J., Le séminaire, livre XIX, …ou pire, texte établi par J.-A. Miller, p. 71.
[19] Cf. Lacan J., « Le malentendu », « Dissolution », Aux confins du séminaire, Texte établi par J.-A. Miller, Navarin Éditeur, 2021.
[20] Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », texte d’orientation à la 1e journée de l’institut psychanalytique de l’enfant, Peurs d’enfants, Navarin, 2011, p. 19.