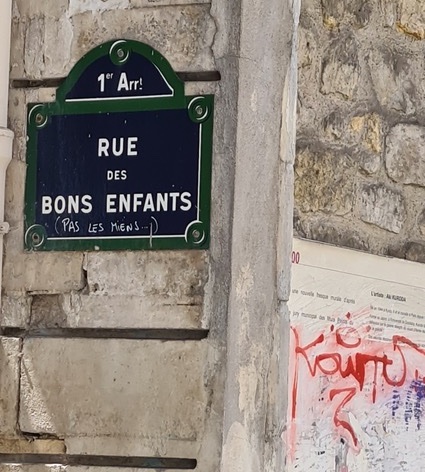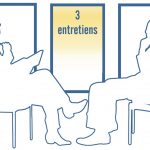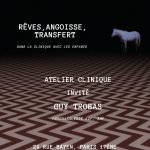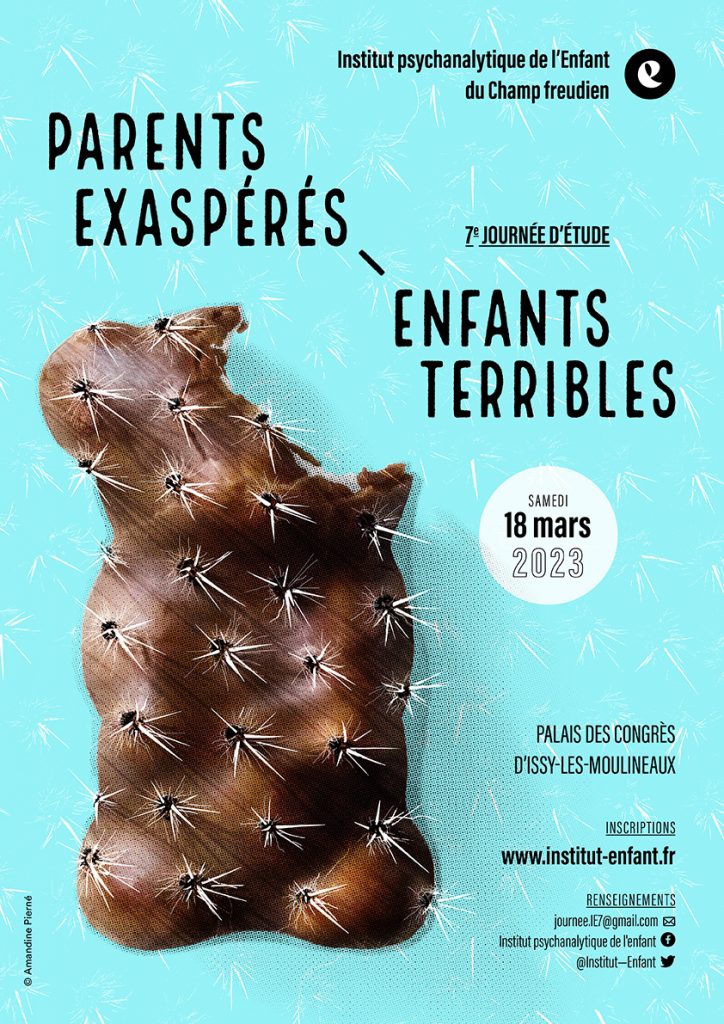Une nouvelle bataille médiatique occupe l’opinion pédago-éducative. Début octobre, une série de fausses informations laisse entendre que le Conseil de l’Europe envisage d’interdire l’envoi d’un enfant dans sa chambre ou au coin. Bien qu’infondée et démentie, cette désinformation a très vite été relayée[1] par les médias, ouvrant un débat qui, depuis, continue[2]. Controverse ouverte entre, d’un côté, les défenseurs de la parentalité positive, plus précisément de la « parentalité exclusivement positive », qui proscrivent le fait de mettre un enfant dans sa chambre, et de l’autre côté ceux en faveur du time-out aussi appelé « temps-mort ».
Une tribune est depuis peu en ligne – les signataires en sont nombreux, de toutes obédiences cliniques, s’insurgeant pour dénoncer la parentalité « “exclusivement” positive » et défendre « une parentalité ferme et bienveillante[3]».
En France, la loi reconnaît que certains enfants sont victimes de violences intrafamiliales. La législation continue d’ailleurs d’évoluer à ce sujet, statuant ces dernières années à la fois sur le statut de victime des enfants exposés à de la violence (novembre 2021) et le fait que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique (juillet 2019). Si ces évolutions récentes font état d’avancées sur la question des maltraitances, elles ouvrent cependant aussi l’espace aux chantres des méthodes dites positives.
Que les courants de la parentalité positive nous viennent d’Amérique du Nord ne surprend pas. Le capitalisme a à la fois des méthodes à vendre, tout autant que son discours promeut l’illimité. La parentalité positive est ainsi une dérivée de la psychologie positive nord-américaine basée sur les émotions et la recherche du bien-être – elle veut le bien d’autrui à tout prix. Son essor a été fulgurant, assorti de sa dimension commerciale (programmes parentaux, coaching, stages, etc.) Relevons quelques axes principaux de cette doctrine : ne pas contraindre l’enfant, être au diapason de ses émotions et de ses besoins, se montrer bienveillant en toutes circonstances, toute forme de réprimande est potentiellement vécue comme une humiliation et/ou de la violence par l’enfant. Le tout appuyé sur l’argumentaire : « à partir des plus récentes recherches neuroscientifiques ».
Au regard des impasses et des polémiques, « la fermeté » et « l’affirmation » sont devenus les nouveaux signifiants compagnons de la parentalité positive : « il s’agira de ne pas vous laisser marcher sur les pieds[4]». Et de fait, une distinction se produit depuis peu entre parentalité positive et parentalité exclusivement positive, ce dernier courant ne se retrouvant pas dans la fermeté et l’affirmation du premier.
Or nous savons, avec Lacan, que la jouissance n’advient au désir qu’à la faveur pour le sujet de l’éprouvé d’altérités pluralisées, étant par ailleurs attendu que ces altérités puissent être en mesure de venir mettre un frein à la pulsion. Comme le rappelle Angèle Terrier, la gêne du parent signe toujours le vouloir-jouir de l’enfant[5]. Ici, la psychanalyse d’orientation lacanienne permet ainsi de sortir de l’impasse du pour ou du contre le fait d’envoyer un enfant dans sa chambre. À considérer l’enfant comme objet a[6], nous pouvons nous intéresser à son traitement particulier en tant qu’objet de jouissance pour chacun de ses parents. Éric Laurent rappelle que « la position psychanalytique consiste à maintenir le sujet à distance de l’idéal et à interroger le réel en jeu dans la naissance de l’enfant, c’est-à-dire le désir ou la jouissance dont il est le produit[7]».
Il va ainsi sans dire, qu’au plus proche de la clinique, il n’y a pas à prendre position pour ou contre, mais plutôt à porter l’attention aux moyens que trouve un parent pour refreiner la jouissance de l’enfant, mais aussi la sienne. Il s’agit alors d’élucider ce qui se joue du côté du fantasme dans le rapport à l’enfant et les modalités que chaque adulte met en acte pour s’en occuper.
Rappelons par ailleurs ici le précieux point d’orientation avancé par J.-A. Miller à propos des pédagogismes : « Il revient à l’Institut de l’Enfant de dégager dans l’éducation la fonction que tient le désir de l’Autre. Cela veut dire aussi mettre en question la jouissance des pédagogues, leur jouissance infâme à opérer par le biais des semblants du savoir sur la jouissance de l’enfant. La vertu des pédagogues n’est souvent que l’habillage d’une jouissance que, même s’ils ne la connaissent pas, peut être qualifiée de sadique, avec les effets d’angoisse qui s’en suivent sur l’éduqué[8]».
[1] Cf. Meteyer M., « “File dans ta chambre !” : un ordre que les parents ne pourront bientôt plus donner ? », Le Figaro, 12 octobre 2022, disponible sur internet.
[2] « File dans ta chambre ! Une punition trop violente ? » France Inter, 27 octobre 2022, disponible sur internet.
[3] Tribune collective, « “La dérive de la parentalité ‘exclusivement’ positive doit être dénoncée” », Le Figaro, 28 octobre 2022, disponible sur internet.
[4] Brochure TePaPo® disponible en Maison des solidarités.
[5] Cf. Terrier A., in « La pratique psychanalytique avec les enfants en institution », conférence organisée par l’ACF Midi-Pyrénées, Toulouse, 10 septembre 2022, inédit, en référence à : Grasser Y., « L’événementiel lacanien », La Petite Girafe, n°28, octobre 2008, p. 100–105.
[6] Cf. Brousse M.-H., « Un néologisme d’actualité : la parentalité », La Cause freudienne, n°60, juin 2005, p. 115–123, disponible sur Cairn.
[7] Laurent É., « L’enfant à l’envers des familles », La Cause freudienne, n°65, mars 2007, p. 49–55, disponible sur Cairn.
[8] Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », in Roy D. (s/dir.), Peurs d’enfants, Paris, Navarin, coll. La Petite Girafe, 2011, p. 17.