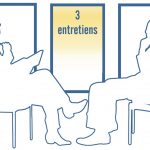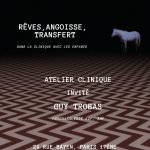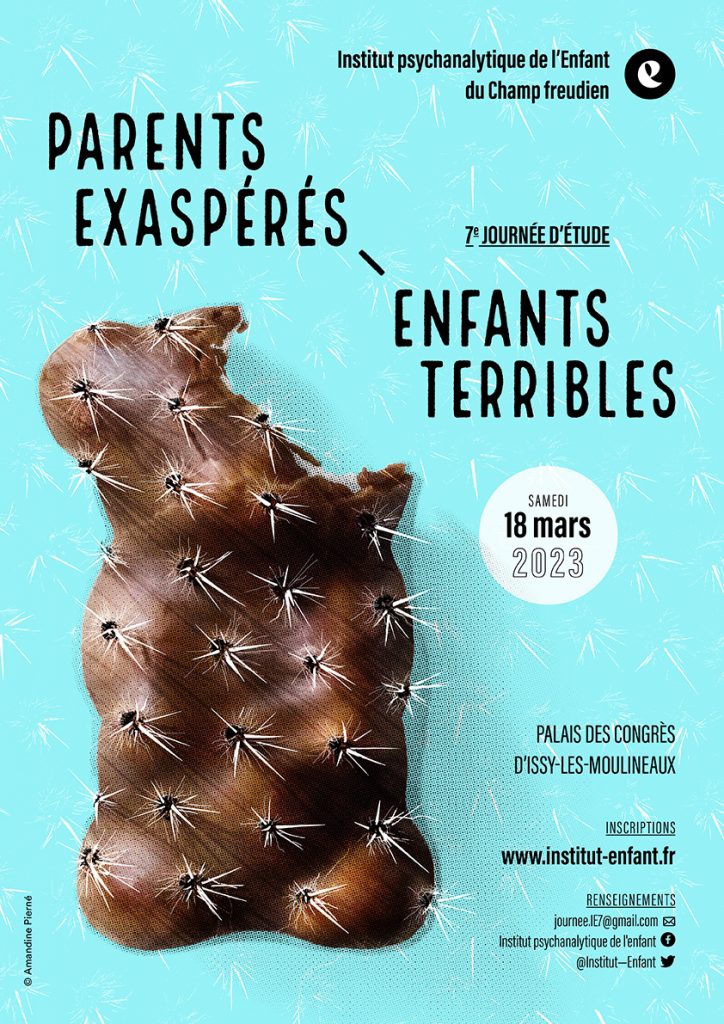Les problèmes de sommeil sont un symptôme contemporain de la petite enfance. Dans l’expérience clinique du CLAP, nous en prenons la mesure quand des familles poussent notre porte ou lors des conversations avec des parents que nous organisons chaque année en partenariat avec une bibliothèque municipale et une autre association. Quand le CLAP a ouvert il y a dix ans, la maire nous a immédiatement sollicités pour animer une discussion sur le thème du sommeil avec des parents d’enfants accueillis en crèche. Quelle lecture pouvons-nous faire de ce malaise contemporain qui touche les familles ?
Krisis, par Sylvia Fiori
Ce que les familles nous enseignent lors de ces rencontres s’éclaire avec les propos de Daniel Roy dans son texte d’orientation. Un enfant qui ne dort pas peut devenir terrible pour ses parents, allant jusqu’à engendrer une crise. Un enjeu s’installe qui « fonde un rapport direct et sans médiation de l’enfant aux parents » et provoque « une prise en masse des corps en présence [qui concentre] l’attention et la libido de tous»1.
Crise vient du grec krisis, qui veut dire « séparer », mais aussi « choisir, juger » ou encore « décider ». Ce symptôme de la petite enfance agite la famille par le malentendu qu’il engendre : lorsque l’enfant est accueilli dans le lit parental ou que l’un des deux parents laisse sa place pour aller dormir ailleurs, un collage des corps se produit. Ce désordre déchire parfois les couples, introduit une rivalité entre les parents et condense les liens symptomatiques qui tissent la famille.
Mais la crise amène aussi ce moment décisif où les familles à bout, désemparées, décident de pousser notre porte en quête de solutions. L’offre de notre lieu d’accueil enfant-parents2 est celle d’un échange avec un père, une mère, un enfant, au plus près de ce qui se dit, un par un. Attraper, dans une contingence, ce que le tout-petit ne peut pas dire, ni aux parents, ni à lui-même, est fondamental. Cela permet d’accueillir le réel de la jouissance en jeu pour chacun et offre la possibilité à l’enfant « de déchiffrer les coordonnées de la place qu’il occupe pour ses parents comme “cause du désir” et comme “déchet de leur jouissance”»3. Chacun peut ainsi accéder à ses propres trouvailles subjectives qui redistribuent les places dans la famille.
Une mère, épuisée et déprimée, à la recherche de spécialistes, pense que son bébé a besoin qu’elle reste tout le temps près de lui pour s’endormir. Un jour, elle le laisse quelques instants et s’aperçoit à son retour que son bébé s’était endormi. Elle réalise alors cette trop grande proximité pouvait exciter son petit. La conversation avec un intervenant du CLAP a fait émerger un savoir de son côté.
Et ce père désorienté qui ne comprend pas pourquoi sa fille de 3 ans se réveille chaque nuit pour le rejoindre. Il remarque qu’elle veut tout le temps jouer à cache-cache, au CLAP comme chez lui. Il nous apprend alors qu’il a enlevé toutes les portes des pièces de son appartement, la chambre de sa fille restant ainsi ouverte. Dans l’échange avec une collègue, il réalise alors que cette absence de délimitation de l’espace empêche son enfant d’établir une frontière entre le dedans et le dehors.
Fort-Da, par Adela Alcantud
Déchiffrer la place qu’il occupe pour sa mère est ce qu’un garçon de 2 ans vient mettre au travail ce jour-là. Il se réveille plusieurs fois par nuit en pleurant. Sa mère est exaspérée : « Pourquoi je n’arrive pas à faire dormir mon enfant ? J’ai sûrement loupé quelque chose ! », dit-elle accablée.
Je lui renvoie : « loupé ? De toutes manières, dès le départ, c’est loupé, car vous êtes tous deux différents ». La mère s’apaise un peu. Mais sans raison apparente, l’enfant se met à pleurer en se blottissant contre le corps de sa mère. Je lui propose alors un jeu avec deux cylindres emboîtables. Je cache le petit jaune dans le grand bleu. Il regarde, intéressé, et dit très clairement : « Pas là ». Il soulève le grand cylindre, attrape le petit et, d’un geste décidé, le jette au loin, hors de sa vue. Je l’interpelle : « il n’est plus là ! Où est-il ? » Cette fois-ci, il ne le cherche pas, mais, il se retourne contre sa mère et pleure à nouveau. Je m’adresse à lui : « Tu as l’air d’être fatigué », et je lui propose de se reposer sur un tapis en lui offrant un plaid de bébé avec un nounours brodé qu’il regarde, content, évoquant cet objet qu’il est pour l’Autre. Je quitte la pièce, le laissant avec sa mère. Quelle n’est pas ma surprise de me rendre compte qu’il arrête de pleurer ! Je reviens sur mes pas. Il essaie de monter sur le tabouret où je m’étais assise. Je l’encourage et l’aide. Le voilà debout sur le tabouret, les bras levés. Il est très fier. Il montre qu’il est un grand sous le regard admiratif de sa mère.
Le mouvement de Fort-Da du garçon, faisant disparaître le petit cylindre le représentant comme objet, est une tentative de s’en séparer. Au moment de partir, il retrouve le petit cylindre jaune lancé au loin et me le rend avec un grand sourire. Par l’écoute attentive et la réponse qu’elle a rencontrée au CLAP, sa mère a pu faire un pas de côté pour se séparer d’un idéal de mère parfaite qui comprend, non sans angoisse, tout de son enfant. Dans son texte d’orientation, D. Roy fait valoir « une fonction de l’objet que l’on peut aussi bien aborder sous l’angle du Fort-Da que sous celui de l’angoisse»4. Cette vignette clinique en témoigne et illustre que la séparation n’a donc pas lieu entre la mère et l’enfant, mais dans l’intersection entre « ce qui circule comme désir et ce qui se dépose de jouissance en jeu, pour chacun des partenaires »5.
1 Roy D., Texte d’orientation vers la 7ème journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, Parents exaspérés-Enfants terribles, disponible sur internet.
2 Le CLAP est une institution d’orientation lacanienne membre de la Fédération des institutions de psychanalyse appliquée.
3 Dans cet extrait, Daniel Roy se réfère à : Miller J.-A., « Préface », in Bonnaud H., L’inconscient de l’enfant. Du symptôme au désir de savoir, Paris, Navarin / Le Champ freudien, 2013, p. 11.
4 Roy D., Texte d’orientation vers la 7ème journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, op. cit.
5 Roy D., op. cit.